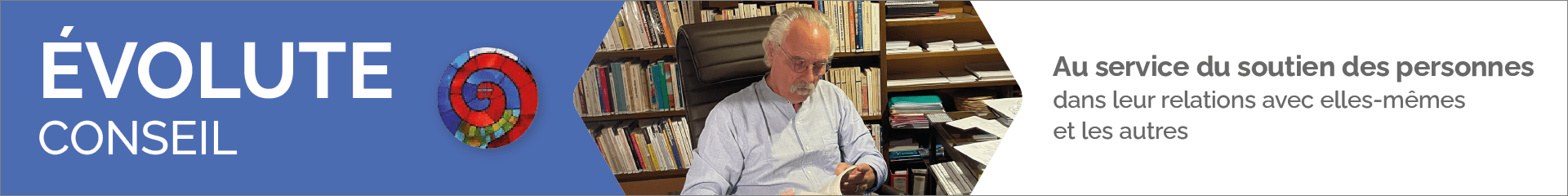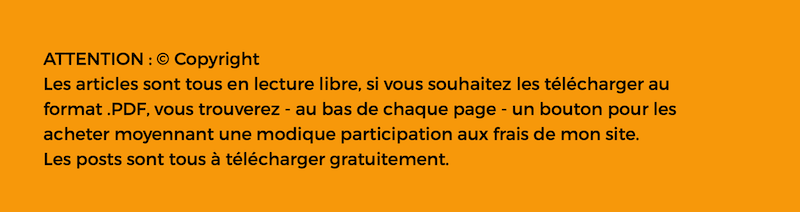« La vocation de l’humanité n’est pas la souffrance mais la joie, elle n’est pas la culpabilité du péché, mais la liberté de la jouissance réfléchie et partagée. »
Robert Misrahi.
Question de Valérie, formatrice :
« C’est toujours un plaisir et une richesse de lire vos divers écrits. Merci pour votre partage. Je fais de la formation auprès de soignantes et régulièrement elles me font part de leur culpabilité à prendre soin d’elles, du temps pour elles. Cette culpabilité a certainement des racines dans leur passé, un lien avec l’estime de soi et peut-être d’autre choses…
C’est un réel frein pour changer même si la prise de conscience est là. Vous serait-il possible de m’éclairer sur cet état ?
Merci à vous. »
Ma réponse :
Il est vrai que notre culture ne nous a pas aidés à « prendre soin de nous ». A contrario, elle nous a – pour beaucoup d’entre nous – contraint à penser que cela était égoïste de prendre soin de soi comme de penser à soi, de prendre du temps pour soi.
J’ai même l’impression qu’il nous faut une sacrée dose de santé mentale pour oser reconnaître que ce n’est pas un mal de penser à soi.
On nous a tellement répété dans l’enfance qu’il fallait penser aux autres que nous avons déduit à tort que c’était mal de penser à soi… Essayons d’y voir un peu plus clair.
En fait le moyen astucieux qu’avaient trouvé nos éducateurs pour nous faire obéir était de nous faire croire qu’il fallait penser aux autres (ils justifiaient ainsi ce qu’ils ne faisaient pas avec nous…)
Prenons un exemple : une maman qui « pense à son enfant » est une maman qui permet l’expression émotionnelle de son enfant donc « l’autorise » à pleurer sans lui dire « tu ne devrais pas pleurer ». Si elle lui dit « tu ne devrais pas pleurer » c’est parce que les pleurs de son enfant sont une difficulté pour elle (elle se dit par exemple qu’elle n’est pas une « bonne » mère et obéissant à son besoin égocentré de l’être, elle interdit à son enfant de pleurer.) Concernée totalement par elle-même, elle ne voit pas qu’en fait, elle obéit à son égocentrisme culpabilisé, et se raconte à elle-même qu’elle fait le bien de son enfant… en l’obligeant à ne surtout pas être fidèle à ce qu’il vit et ressent, donc en inhibant ses émotions.
Dans un tel contexte, l’enfant aura appris que quand il ressent l’émotion qu’il ressent, c’est mal de la ressentir. Imaginez le degré de névrose d’un cerisier qui se dirait que c’est mal de faire des cerises et qu’il aurait été préférable de faire des abricots !
Si l’enfant se conforme ainsi aux dictats de son parent (« Non, tu n’as pas mal », « Tu n’as aucune raison d’être en colère parce que ce que je te dis est juste »), c’est parce qu’il n’a aucun moyen de s’y opposer puisqu’il a appris, sent et sait, depuis sa naissance, que son parent détient sa survie. Il en arrive donc à croire que même les choses qui s’avèrent fausses que lui ont apprises ses parents, sont vraies, et peu à peu il pense (parce qu’on ne cesse pas de le lui répéter) qu’il ne devrait pas avoir les émotions qu’il a, il se renie lui-même au profit de l’image que veulent de lui ceux qui détiennent sa survie et prétendent l’aider.
Ainsi il apprendra la division, la non confiance en lui, il apprendra le mensonge et tremblera en doutant de lui, par soumission à ceux qui lui disent qu’il n’est pas conforme.
Comme la plupart des personnes pensent, dans leur égocentrisme propre, qu’il est toujours préférable que « les autres » agissent selon leurs critères à eux (et non pas selon les critères propres à chacun), beaucoup de parents pensent que leur enfant est né pour incarner leur idéal. Or personne ne naît « pour » quelqu’un d’autre, personne n’est par nature la chose de l’autre.
C’est ainsi que d’une manière insidieuse et culpabilisatrice, les parents tenteront de convaincre leurs enfants qu’ils ne devraient pas avoir les besoins émotionnels qui sont les leurs. Voici quelques exemples de leurs injonctions négatives :
- Que tu es vilain quand tu pleures !
- Un grand garçon n’a pas mal.
- Tu n’es pas belle quand tu es en colère.
- Oh ! La vilaine petite fille qui fait un caprice !
Au besoin, quand cette tentative de manipulation psychologique fonctionne mal, ils tentent de les convaincre que de toutes les façons, eux adultes, sont les plus forts et, pour cela, utilisent diverses méthodes :
Ils peuvent affirmer leur domination en la criant (haut et fort) :
- Tu m’obéis ou tu fous le camp !
- Je vais te faire passer l’envie de me répondre.
- Je te lave la bouche au savon si tu répètes encore des gros mots.
Parfois, d’une manière plus perverse, ils humilient leur enfant et abusent de leur pouvoir en tentant de lui faire croire des choses fausses, mais qui leur font très peur :
- Tu resteras toute ta vie la bouche de travers si tu fais des grimaces.
- Arrête de manger comme un(e) cochon(ne) sinon ton nez va se transformer en groin.
- Si tu te masturbes, tu deviendras sourd.
- Si tu travailles mal à l’école, tu seras balayeur.
Parfois, ils essayent le chantage :
- Je te laisse tout seul te débrouiller, (tentant de se servir de la solitude comme d’une menace), dorénavant je ne m’occuperai plus de toi.
- Je m’en vais, pour toujours, (tentant de le faire souffrir en le persuadant de sa dépendance.)
- Tu fais beaucoup de mal à ta mère quand tu fais ça, (tentant de le rendre honteux.)
Enfin certains s’attaquent à l’intégrité physique de l’enfant en le menaçant de « châtiments corporels » :
- Tais toi ou je t’en colle une !
- Mange ta soupe ou je te la fais manger.
- Arrête de m’énerver, y’a des baffes qui se perdent.
- Dis merci sinon ça va mal finir.
On comprendra aisément (?) que dans un tel contexte d’apprentissage de la vie la plupart d’entre nous n’ayons pas confiance… en nous, et que nous continuions à croire (parce que nous les avons crues dans le passé) les sornettes qu’on nous a racontées à grand renfort de menaces et de tentatives d’intimidations.
On comprendra également aisément qu’un certain nombre d’êtres humains soient réduits à penser que la violence et la cruauté sont des modes de relation « normaux », parce que (pour paraphraser Alice Miller(1)), on est violent parce que dans une situation similaire, alors qu’on était sans défense, on a soi-même été violenté et contraint de considérer cela comme un témoignage d’amour.
Comme vous, je pense que la culpabilité est un réel frein pour changer.
Certains psychothérapeutes ont même centré l’essentiel de leur travail là-dessus.
Quand, après avoir été envahis par la Chine, les Tibétains se sont ouverts au monde et à des cultures bien différentes de la leur, des psychologues d’universités américaines leur ont demandé ce qui les frappait le plus dans notre culture. De nombreux Rinpochés ont répondu que c’était notre propension à culpabiliser, qu’ils ne savaient pas (avant d’avoir rencontré la culture occidentale) qu’il était possible pour un être humain d’être à ce point contre lui-même.
Françoise Dolto, elle, disait avec simplicité de la culpabilité qu’elle est « un violent poison pour l’être humain. »
Regardons maintenant d’un peu plus près la manière dont la culpabilité fonctionne à l’intérieur de notre mental.
La culpabilité est une simple émotion causée par une idée fausse à laquelle nous croyons. (Et nous n’y croyons que parce que dans notre innocence, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’y croire.) Cette idée fausse sous-entend qu’au moment où nous avons agi, nous aurions pu agir autrement.
Or – comme nous l’avons vu – du point de vue des autres, ce que nous avons fait peut être considéré comme une erreur (surtout cela ne leur plaît pas.) De même que de notre propre point de vue, ce que nous avons fait peut nous sembler être une erreur, par la suite.
Mais au moment où nous avons fait ce que nous avons fait, si nous l’avons fait, c’est simplement parce qu’à ce moment là, cela nous apparaissait comme un bien pour nous, donc qu’il nous était impossible (à ce moment là) d’agir autrement.
Il m’est souvent arrivé en formation de demander : « Quels sont parmi vous ceux qui se lèvent le matin en se promettant de faire quelques belles erreurs dans la journée ? » Comme vous pouvez vous en douter, je n’ai jamais eu de réponse.
En fait la culpabilité est liée au désespoir de celui qui – ayant appris à se juger – a oublié qu’il est inévitable qu’il commette des erreurs, compte tenu de sa condition humaine, et qu’il n’y a pas un seul domaine de l’existence où il est possible de progresser sans faire d’erreur.
La culpabilité est l’erreur du désespoir. Dans la culture judéo-chrétienne, elle est le « péché de Judas » qui, ayant désespéré de l’amour du Christ, s’est pendu.
Pourquoi devrions-nous nous pendre ?
Nous sentir coupables de nos erreurs ne fait que rajouter une erreur à une liste déjà longue.
Ainsi vos stagiaires ayant pour la plupart reçu peu d’amour de leurs éducateurs (ou, en tout cas, un amour très conditionné) n’ont pas d’autre recours que de penser (parce qu’ils l’ont appris) que « c’est mal de penser à soi », que c’est égoïste.
Parce qu’ils ont appris que l’égoïsme c’est de penser à soi, (qu’ils interprètent comme « ne penser qu’à soi »), ils n’ont sans doute jamais pris conscience que puisqu’ils vivaient, ils avaient à respecter la vie en eux, c’est-à-dire à penser à eux. Ils ne se permettent pas de faire ce qu’ils aiment (aller danser de temps en temps par exemple, ou marcher en forêt), lorsque leurs conjoints ne partagent pas leurs passions.
Ainsi ils maltraitent la vie en eux, en ne respectant pas des désirs légitimes, et expliquent qu’ils doivent « prendre sur eux », c’est-à-dire « contre » eux ! Au lieu de faire cette promenade en forêt qui lui ferait tellement de bien, qui la rendrait heureuse et lui permettrait d’être en harmonie avec elle et les autres, cette femme décide que son devoir est d’aller faire le ménage chez sa mère le week-end, ce qui lui coûte énormément.
Ils « stressent » parce qu’ils pensent que pour être conforme à « ce qu’ils doivent être » (leur idéal), ils doivent renoncer à « ce qu’ils sont. »
Ils n’ont pas encore découvert qu’ils ont le droit « d’être ce qu’ils sont. » Par exemple plutôt lents, s’ils sont plutôt lents et maladroits, parce que ça leur arrive. Enfermés dans leur peur, ils pensent qu’ils n’ont pas d’autre choix que celui d’être conforme à ce que les autres attendent d’eux, c’est-à-dire de la rapidité et de l’adresse ! Et parce que ça ne leur sera pas toujours possible, ils culpabilisent et souffrent !
La véritable connaissance (qui remettrait en cause l’autorité de leurs parents) leur reste interdite : celle qui leur permettrait de comprendre que ce n’est pas égoïste de dire « non » à l’autre, puis de découvrir que tel est pris qui croyait prendre et que le véritable égoïsme est de vouloir que les autres se conforment à notre attente.
Je me souviens de cette AS, mère célibataire de deux jeunes enfants, à qui sa mère, ne supportant pas la solitude de son veuvage, demandait qu’elle vienne la voir tous les jours, et qui sanglotait devant ce qu’elle appelait « l’injustice de la vie » (son incapacité à gérer sa culpabilité qui lui imposait d’accepter une charge beaucoup trop lourde pour elle).
Pour qu’il y ait culpabilité, il faut un juge. La culpabilité est l’émotion qui nous fait nous rejeter nous-mêmes parce que nous avons appris à nous juger, parce que nous avons mis un « Juge » dans notre cerveau. Le seul moyen à notre disposition pour nous en débarrasser est de découvrir comment nous nous y prenons avec nous-mêmes pour nous faire souffrir avec notre « Juge intérieur » afin de ne plus le faire.
Au cours de ce travail de conscience de soi, certains culpabiliseront… de continuer de culpabiliser. Le Juge, d’autant plus habile qu’il a été savamment intériorisé, veut toujours avoir le dernier mot.
Il s’agit donc d’un travail de lucidité. Notre conscience, parce qu’elle est réflexive, nous permet de voir, comme dans un miroir, comment nous nous y prenons, sans cesse, avec nous-mêmes. Ensuite, parce que nous serons convaincus de notre erreur répétitive, il nous restera inlassablement à en tirer des leçons pour ne plus devoir la reproduire : je vois très clairement la manière dont je m’y prends avec moi-même pour culpabiliser et je mets au point une tactique pour éviter de continuer :
D’accord, j’ai fait une erreur, d’accord j’accepte de l’avoir faite, d’accord je ne pouvais pas (au moment où je l’ai faite) m’y prendre autrement. Oui, j’ai le désir, de toute la force de mon intention, de ne pas la reproduire parce que j’ai clairement vu que c’était une erreur. Non, je ne m’en veux aucunement car je ne pouvais pas faire autrement.
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Peu à peu, le Juge, intériorisé depuis si longtemps, sera ébranlé. Il est possible pour chacun de nous de désapprendre ce que nous avons appris, cela demande du courage et de la détermination et c’est à chacun – avec lui-même – de sentir ce qu’il a envie de faire de ses croyances, de ses « fausses lois. »
Prenons un exemple de culpabilité ordinaire à partir duquel chacun pourra extrapoler et travailler sur ses culpabilités personnelles :
Il est 17h, une mère rentre de son travail avec son petit enfant de, disons six ans, qu’elle vient de ramener de l’école. Elle range les courses qu’elle vient de faire dans son placard et son petit bonhomme lui répète qu’il voudrait 50 centimes pour aller acheter quelques bonbons à l’épicerie située de l’autre côté du village. Elle lui répond tout d’abord qu’elle ne lui donnera rien du tout, qu’elle a fait un bon dessert et qu’ils se régaleront de sucré un peu plus tard. Devant son insistance, elle finit par céder, lui donne les 50 centimes et le garçonnet sort de la maison en courant, traverse la route nationale, se fait renverser par une voiture et se retrouve à l’hôpital.
Pour peu que son enfant reste infirme après cet accident, il y a fort à parier pour que – dans notre culture – cette femme se hante elle-même par sa culpabilité et ses reproches. « Jamais je n’aurais dû céder à sa demande de bonbons, tout est de ma faute. » Et le fameux : « Si je ne lui avais pas donné les 50 centimes, mon enfant ne serait pas infirme aujourd’hui. »
Il faudra beaucoup de force et de courage à cette mère pour constater qu’elle-même (son intention) n’est pour rien, absolument rien, dans cet accident. Savait-elle (au moment où elle lui a donné l’argent) que son fils allait se faire renverser par une voiture ?
Qu’elles soient petites ou graves de conséquences, nous ne pouvons pas ne pas commettre d’erreurs puisque nous ne savons pas que nous en commettons au moment où nous agissons !
Les causes de l’accident de cet enfant sont multiples et remontent à l’origine des temps dans un enchaînement sans fin. Ainsi nous pouvons – par exemple – évoquer pêle-mêle, la vitesse de la voiture qui a percuté l’enfant, l’attention de son conducteur, la pression des pneus de sa voiture, la courbe de la route, la vitesse de la course de l’enfant, son désir de bonbons, le fait qu’il pleuvait ce jour-là… etc. La manière dont une rencontre se fait en un instant unique, se déploie à travers l’univers et nous ne pouvons rien contrôler.
Il y a une infinité de causes et de conséquences qui ont amené cet enfant-là à avoir cet accident-là. S’en sentir coupable est une erreur, la culpabilité est liée à l’arrogance de celui qui pense que la vie est à ses ordres et qu’il est la seule et unique cause de ce qui lui arrive.
Si cette femme – avec humilité – veut bien reconnaître la réalité, elle sera obligée de constater qu’elle-même n’est pour rien dans l’accident de son enfant, même si la vie s’est servie d’elle comme de l’une des causes (au moment où elle a donné les 50 centimes), parmi une infinité d’autres, pour concourir à cet accident unique. « Elle », c’est-à-dire « son intention », n’est pour rien là-dedans. Le ressentant au plus profond d’elle-même, elle restera en paix, à son humble place d’être humain, incapable de prévoir le futur. Car il est de notre devoir de tout faire pour tenter de le prévoir (en mettant par exemple les couteaux aiguisés hors de portée des petits enfants), puis d’accepter de tout notre être que nos propres prédictions soient erronées.
« Mon Dieu donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse d’en voir la différence », dit une prière stoïcienne attribuée à Marc-Aurèle.
Vous évoquez des soignantes qui ont du mal à accepter de « prendre du temps pour elles ». Il est une nouvelle maladie, produit du monde moderne, produit du concept faux mais intéressé « Le temps c’est de l’argent », qui est de penser qu’il devrait toujours être possible de faire plus, de produire plus, dans le même espace de temps donné. Beaucoup de personnes en sont les victimes, la psychologie moderne appelle cela l’includence : « Sentiment de ne pas avoir le temps de tout faire en un temps donné. » Cette « folie mentale » occasionne notamment des heures supplémentaires « librement » choisies et empiétant largement sur la vie privée de salariés stressés.
Pourquoi beaucoup d’entre nous ne sommes-nous pas capables de mettre sainement une limite à une manipulation perverse qui nous « roule dans la farine » parce qu’on y croit ? Pourquoi la plupart d’entre nous sommes-nous encore réduits à penser que nous devons faire ce que nous ne pouvons pas faire (au risque de notre propre équilibre) ? Pourquoi nous en voulons-nous de ne pas avoir fait ce que nous n’avons pas pu faire ? Parce qu’il est un Juge à l’intérieur de nous qui nous contraint, comme des enfants punis, à trembler devant son autorité et à renoncer à nos désirs légitimes. Un juge qui nous culpabilise… avec l’assentiment que nous lui donnons !
Aider des personnes qui culpabilisent est une tâche délicate… car si nous nous y prenons maladroitement, nous risquons de renforcer ce que nous nous proposons de prévenir.
Le travail sur la culpabilité n’est possible que parce qu’il y a la confiance. Je l’ai vérifié récemment quand, dans une relation thérapeutique, une personne m’a renvoyé dans un sourire… « Avec vous c’est différent, je ne culpabilise pas. » Je crois cette phrase très éclairante parce qu’elle montre la différence entre la relation avec son thérapeute et les relations ordinaires. La relation thérapeutique permet de se regarder soi-même avec un regard différent. Certaines personnes, pour la première fois de leur vie, vont ainsi pouvoir poser un regard bienveillant sur elles-mêmes, parce que quelqu’un d’autre a osé le faire préalablement.
Si le regard du thérapeute conditionne le regard que celui qui est en thérapie va avoir sur lui-même, le regard du formateur, dans un groupe, conditionnera en partie la manière dont les participants se percevront eux-mêmes.
Alice Miller(1) – dont je ne saurai trop recommander la lecture à la formatrice que vous êtes – ne dit-elle pas : « Nous ne pouvons pas nous libérer d’un mal sans l’avoir nommé et jugé comme un mal. » Pour se libérer d’un mal, chacun a besoin d’un « témoin » qui commence par faire avec lui ce qu’il fera avec lui-même plus tard.
Ce témoin peut, bien sûr, être un parent, un ami, un thérapeute, un formateur, en tout cas un « aidant » – car c’est cela aider – c’est-à-dire une personne qui a commencé de faire avec nous ce que nous ferons après avec nous-mêmes d’une manière autonome. Un peu comme un parent qui apprend à son petit enfant à marcher, en lui tenant la main (au début), en le laissant faire l’expérience de tomber (aussi), et de se relever, parce qu’on apprend mieux quand on se relève tout seul.
Un parent garant d’une bienveillance qu’il ne nous est pas encore toujours possible d’avoir pour nous-mêmes (mais n’est-ce pas tout le sens d’une éducation véritable ?)
Cela ne sera possible que si ce parent, ami, thérapeute, formateur a déjà fait avec lui-même ce qu’il se propose de faire avec l’autre. (Et je vous invite pour poursuivre votre réflexion à lire mon article : « Se situer et trouver le bon thérapeute ».
Il me reste maintenant à analyser avec vous l’objection principale de mon potentiel contradicteur :
« Mais alors, si nous ne culpabilisons plus, c’est la porte ouverte à toutes les exactions ! La culpabilité avait au moins le mérite de rendre honteux ceux qui en étaient la proie ! »
C’est vrai que nous sommes issus de la culture de la punition. Or la punition ne permet pas à un être humain d’apprendre à assumer ses actes, elle lui permet tout juste d’en avoir peur, elle mine donc (comme vous le pressentez dans votre question) sa propre estime de lui-même. La seule manière, pour un être humain, de pouvoir ne pas indéfiniment répéter ses erreurs c’est de les reconnaître comme telles, ce que justement la culpabilité interdit.
Pour qu’il puisse assumer ses actes, un être humain doit s’en sentir responsable. Pour s’en sentir responsable, il doit développer en lui l’inverse de ce que la culpabilité génère : le sentiment d’honneur de soi (permis par l’amour de soi) qui rend possible la reconnaissance de ses erreurs.
La reconnaissance des erreurs ne peut pas se faire dans la menace et la peur. (C’est la raison pour laquelle il n’est pas utile de faire ressentir son erreur à l’autre tant que nous n’avons pas préalablement vérifié qu’il peut s’en sentir responsable.)
Après les émeutes de novembre 2005, un jeune délinquant partageait : « Un bébé quand il a faim, i pleure, ben nous, quand on casse et brûle des voitures, c’est notre façon de pleurer », nous donnant par là même la clé du sens de ses actes. Parce qu’il a eu le sentiment d’être compris par son interlocuteur, il a pu poursuivre : « Je voudrais devenir ce qu’il y a de beau en moi ! »
C’est parce qu’il n’en a pas honte et qu’il ne ressent pas le besoin de se dévaloriser à propos des actes qu’il a commis qu’un être humain peut reconnaître et assumer ses erreurs. La dévalorisation est le mécanisme qui empêche la personne de braver son consentement à la culpabilité (parce qu’elle se sent honteuse et qu’elle craint la sanction) elle se juge misérable en se culpabilisant.
Pour permettre à un jeune délinquant de devenir responsable de ses actes, il y a besoin de lui rendre son honneur et sa dignité (et si on écoute ces délinquants, on s’apercevra qu’ils ne cessent pas de le crier.)
« L’homme ne veut pas être, mais paraître. Il ne veut pas voir ce qu’il est, mais essaie seulement de se prendre pour le personnage pour lequel les gens le prennent quand ils parlent de lui », disait S. Prajnanpad (2). Poser sur un être humain un regard respectueux de ce qu’il est, c’est l’aider à être, plutôt qu’à paraître, c’est donc entrer en relation avec lui sur la base du respect que nous devons à l’être humain et encore plus particulièrement à ceux qui (trop blessés eux-mêmes) ne nous respectent pas.
Pourquoi un statut spécial pour ceux qui ne nous respectent pas ? Parce que nous savons ce que nous voulons et que notre objectif est d’obtenir la rencontre plutôt que de créer des bêtes fauves. De même nous avons besoin de poser un regard particulièrement bienveillant sur le « délinquant en nous » qui culpabilise plutôt que de relever la tête en assumant ses erreurs.
Notre système d’éducation crée – bien trop souvent – des victimes qui peuvent devenir dangereuses quand elles ne sont pas reconnues dans leur besoin d’humanité. Et se reconnaître soi-même dans son besoin d’humanité, c’est d’abord arrêter de s’en vouloir des erreurs que l’on a commises, c’est arrêter de culpabiliser.
Avec la haine et le ressentiment contre ce qui, en nous, comme en l’autre,« aurait dû… », nous obtiendrons la soumission ou la révolte (regardez autour de vous !) jamais la rencontre, avec un être humain libre.
La culpabilité est donc antinomique de l’amour de soi et du « prendre soin de soi. »
S’aimer soi-même, c’est ne plus céder aux sirènes perverses de la culpabilité et oser se voir pour ce que l’on est : ici un être humain maladroit, là un être humain qui a menti mais qui n’en est pas pour autant un « menteur », parce que ce que nous faisons est différent de ce que nous sommes.
L’antidote de cette maladie c’est devenir responsable de ce que l’on a fait parce que nous sommes les auteurs des gestes que nous avons posés. Et c’est la prise de conscience de cette responsabilité qui permettra à chacun d’agir en voyant clairement ce qui peut être fait, par exemple en faisant tout ce qui est humainement possible de faire pour réparer ici maintenant, l’erreur passée.
Aider celui qui a fait une erreur, c’est lui permettre de la réparer sans qu’il se sente humilié de la réparer, et c’est ce que ce monde de la mauvaise conscience et de la culpabilité sait si mal faire avec ses jeunes.
Si, comme le dit Aldous Huxley, « Ce que l’on est dépend de trois facteurs : ce dont on a hérité, ce que le milieu a fait de nous, et ce que nous avons fait de ce dont on a hérité et de ce que le milieu a fait de nous, » chacun d’entre nous pouvons découvrir que la culpabilité n’est que la forme archaïque de notre responsabilité d’être humain et qu’il nous est possible de la transcender pour devenir ce que nous sommes.
Notes :
1. Alice Miller(1) : voir ICI.
2. S. Prajñânpad(2) : (1891 – 1974), sage et thérapeute indien – qui a proposé, entre psychanalyse et Vedânta, une voie originale vers la liberté.
© 2007 Renaud PERRONNET Tous droits réservés.
La culpabilité vue par Voutch :
- Tu es un boa. C’était une souris. Les boas mangent les souris. Tu n’as aucune raison de te sentir coupable.
- En plus, c’est très mauvais pour la digestion.
Cet article vous a intéressé(e) vous pouvez le télécharger en podcast Mp3 (durée 25 mn), que vous pourrez facilement écouter sur votre appareil mobile ou votre ordinateur :
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article (8 pages) au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Pour aller plus loin, vous pouvez lire mon article :
Vous pouvez aussi télécharger la fiche pratique inédite :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
17 230 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)