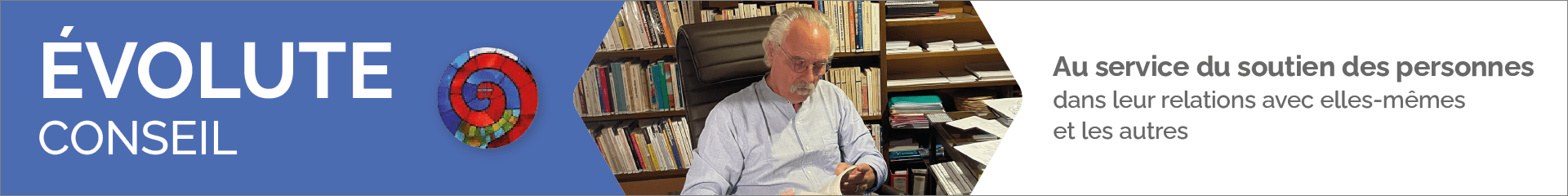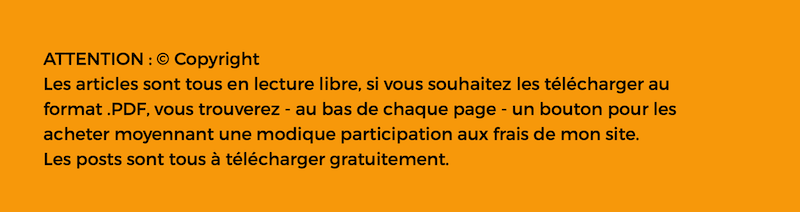Le risque du manager en établissement de santé : ne pas savoir s’y prendre avec ses collaborateurs et induire la maltraitance.
Contribution à une pédagogie de la relation interpersonnelle du management.
Et plus généralement… apprendre à entrer en relation avec l’autre.
« Lorsque quelqu’un te met en colère, sache que c’est ton jugement qui te met en colère. »
Epictète, (philosophe grec, stoïcien, 1er siècle avant J-C.)
Dans ma pratique d’accompagnement des personnes soignantes, il m’a été maintes fois donné de constater les dysfonctionnements de tel ou tel service et de découvrir que 9 fois sur 10, ils avaient pour cause une mauvaise communication interpersonnelle.
Soit le personnel considérait son supérieur hiérarchique comme une « peau de vache » à l’autorité cassante et incapable d’écoute, soit comme trop laxiste, incapable de faire respecter une consigne, donc de gérer son équipe.
Lorsque j’anime des groupes composés de cadres infirmiers, les difficultés qu’ils expriment découlent de ce dont se plaint le personnel : consignes pas ou mal respectées par certains qui ne supportent pas les remarques, se rebiffent agressivement ou se réfugient dans un rôle de victime avec mises en maladie à répétition ou tentatives de chantage à peine déguisées.
Il arrive aussi qu’un service fonctionne bien : personnel enthousiaste, ambiance positive, gestion saine des conflits. En y regardant de près, on se rend compte que le responsable de ce service sait gérer son équipe, c’est-à-dire l’ensemble des relations humaines qui la composent. En fait, il sait écouter son personnel et faire des remarques à l’un ou l’autre sans qu’ils se sentent agressés ou blessés, il sait communiquer.
Nous allons donc réfléchir à ce que nous appellerons l’art d’une « pédagogie de la relation » en nous demandant :
- Quelles sont les remarques qui sont inacceptables pour la plupart d’entre nous et pourquoi ?
- Quelles sont les remarques qui – bien qu’elles soient audibles – sont nuisibles à la communication interpersonnelle et pourquoi ?
- Comment est-il possible de formuler une remarque de telle manière qu’elle soit entendue et acceptée ?
Car il est évident que l’ambiance d’un service comme la qualité relationnelle des personnes qui le composent est pour beaucoup dans la qualité du travail de ses membres. Et que si un responsable se doit de faire certaines remarques, il n’a aucun intérêt à ce qu’elles bloquent le fonctionnement de l’équipe.
Quelles sont donc ces remarques qui sont inacceptables pour la plupart d’entre nous et pourquoi ?
« Sylvie, je vous ai déjà dit 100 fois que je voulais que tous les gants à usage unique soient rangés au même endroit ? » (Sylvie fulmine intérieurement et se met à ranger avec mauvaise volonté.)
Comme Sylvie, nous détestons tous (ou presque) nous sentir traités comme des enfants, donc il est toujours maladroit d’adresser une remarque à l’autre à la manière d’un parent donneur de leçon.
En effet, parce que nous avons tous eu – étant enfant – à subir une autorité parentale souvent maladroite, il y a de fortes chances que si le manager formule ses remarques en employant le même discours moralisateur qui fait appel aux notions de bien et de mal que celui utilisé par la plupart des parents, il risque de créer chez nous une forme de révolte contre lui et ce qu’il veut nous faire comprendre.
Ce cadre de santé ne le sait sans doute pas quand il dit à une aide-soignante : « Sandrine, ne venez pas vous plaindre si vous avez mal au dos, ça fait dix fois que je vous dis d’utiliser le lève malade mis à la disposition du service. »
Ce cadre infirmier non plus qui, agacé de devoir répéter inlassablement les mêmes consignes, s’exclame : « Michèle, je vous ai encore vue ce matin entrer dans la chambre de Madame X sans lui dire bonjour, vous devriez avoir honte ! »
Même si les remarques de notre supérieur hiérarchique sont justifiées, elles font naître chez nous un sentiment d’injustice par la manière dont elles sont exprimées. Elles entraînent ainsi souvent chez nous la réaction opposée à celle attendue par celui qui nous les fait.
Sandrine – au détriment de son dos – risquera de mettre un point d’honneur à ne jamais utiliser le lève malade ! Michèle continuera sans doute à « oublier » de saluer certains patients en fulminant intérieurement contre l’injustice de son chef.
Une autre, culpabilisée par son supérieur, risque de lui donner intérieurement raison et d’en profiter pour s’adonner à des pensées négatives envers elle-même pour se dévaloriser.
« Vous devriez avoir honte », entraîne chez certains « Il a raison, je suis nulle », la personne s’identifie à son juge extérieur pour mieux juger (avec son juge intérieur) l’acte qu’elle a commis dans le passé et avoir mauvaise conscience, ce qui alourdira l’atmosphère du service car elle se sentira mal à l’aise.
Prenons le cas d’une aide-soignante qui a tutoyé une personne âgée, alors que la consigne lui demande de l’éviter. Si elle l’a fait, c’est parce qu’au moment où elle l’a fait, elle pensait que c’était juste pour elle de le faire, ayant oublié, par exemple, la consigne. Après coup, il lui sera peut-être possible de découvrir qu’elle a fait une erreur en ne respectant pas la consigne, mais n’oublions jamais que sur le moment, comme chacun de nous, elle a agi sur la base de ce qui lui apparaissait juste et bien pour elle[1]. Ce qui n’exclut certes pas l’erreur dont elle est responsable parce que c’est bien elle qui a tutoyé ! Rien à voir avec la (fausse) croyance qu’elle aurait pu ou dû agir autrement, donc avec la culpabilisation (« je n’aurais pas dû agir comme j’ai agi »).
La culpabilité met sous l’emprise du juge intérieur et empêche la « victime » de prendre la responsabilité de ses actes ou de ses paroles, le « ce n’est pas ma faute. » Cette culpabilité est un poison parce qu’elle nous empêche d’assumer pleinement nos actes, contraints que nous sommes par l’angoisse de reconnaître que nous les avons commis, issue du jugement que nous portons sur nous ! La culpabilité, c’est la maladresse de celui qui, en s’en voulant, rajoute une erreur à une erreur.
Une aide-soignante qui culpabilise est une aide-soignante qui a peur des répercussions de ses actes, et que sa peur empêche de les assumer.
Si je suis son supérieur hiérarchique, comment vais-je m’y prendre pour l’aider à oser devenir davantage responsable de ses actes plutôt que victime ? La juger, la stigmatiser comme « coupable » n’a comme effet que de la faire se sentir encore plus mal à l’aise donc encore davantage victime, passive et fuyante.
Il est vrai – comme je l’ai déjà mentionné plus haut – que la difficulté que nous rencontrons à ne pas vouloir culpabiliser l’autre vient aussi du fait que le discours moralisateur est celui qui nous arrive le plus spontanément aux lèvres, étant donné que c’est celui que nous avons le plus souvent entendu pendant toute notre enfance et toute notre adolescence. Généralement, nous ne faisons que reproduire ce à quoi nous sommes habitués, sans y réfléchir ni nous interroger sur l’opportunité d’une « pédagogie de la relation ». Sans nous interroger sur ce que l’on nomme « l’effet contraire[2] » en pédagogie.
La plupart d’entre nous n’aimons pas nous sentir jugés, parce que nous avons besoin de nous sentir reconnus, dans un monde qui – souvent – privilégie la critique négative à l’encouragement.
Souvenons-nous comment nous avons appris à être sensible à l’injustice alors que nos éducateurs, incapables d’apprécier les 14 notes positives (au-dessus de la moyenne) que nous avions obtenues, pointaient agressivement la note négative !
La relation d’autorité maladroite tient bien peu compte de l’autre, elle s’établit sur la base du rapport de force, de la relation « moi d’abord », d’abord ce que j’ai à dire, et se moque du vécu de l’autre comme de sa sensibilité. Elle tente de dominer (au besoin par la punition.) Là, elle ne produit un résultat qu’autant qu’elle est capable de maintenir cette domination dans la durée. Les dictateurs le savent, dans leur vigilance à tout mettre en œuvre pour maintenir la terreur en permanence.
Mais revenons à « nos » managers : quand, pour une raison ou pour une autre, le manager autoritaire relâche sa pression, il risque de devenir la victime de son employé qui n’attendait que ça ! Ce dernier refusera, par exemple, de lui rendre un service le jour où il en aura le plus besoin. Quel gaspillage d’énergie ! Quel dommage pour le service que cette non compréhension de l’importance de la solidarité entre ses membres !
Si nous avons tendance à dominer, c’est parce qu’ayant été dominés dans le passé et contraints de refouler notre colère, nous ne pouvons que nous tendre en nous sentant mal à l’aise dans la relation interpersonnelle.
Or seul un être humain détendu peut dire les choses sans agressivité.
En fait, et cela devient plus subtil, le manager qui veut dominer est dans la confusion. S’il admet volontiers que l’autre est responsable de lui-même, il ne voit pas qu’il est – lui aussi – responsable de ce qu’il ressent par rapport à ce que l’autre lui a fait, comme il est responsable de ce qu’il lui fait en retour.
Souvent la confusion des responsabilités s’installe. « Si je lui ai répondu sur ce ton, c’est normal, regardez la manière dont il m’a parlé ! » Autrement dit, c’est à l’autre que je veux faire porter la responsabilité de mes actes. Nous entendons souvent ce type de propos erronés : « Si je suis dur avec lui, c’est de sa faute, c’est son attitude qui m’oblige à la dureté ! »
Pourtant, ce que je fais, c’est bien moi qui le fais, cela ne peut pas être autrement : je suis responsable de moi à 100%. C’est bien moi qui ressens ce que je ressens et qui suis l’auteur de mes actes. De même, l’autre reste à 100% responsable des actes ou des paroles dont il est l’auteur.
« C’est à cause de l’autre » est le piège de l’aliénation, parce que si je pense que ce que je dis, fais ou ressens est à cause de l’autre, je n’ai aucune possibilité d’y changer quoi que ce soit. Je deviens le prisonnier de l’autre en étant contraint par lui.
Par contre, si je deviens capable de ressentir que c’est toujours moi qui suis à l’origine de ce que je dis, fais ou ressens, je suis libre. Je suis libre (de faire ou de ne pas faire) parce que je suis responsable.
Même si, dans le contexte du management, nous sommes bien facilement portés à penser que nous ne sommes pas vraiment les auteurs de nos réactions, parce que les autres nous poussent souvent à bout, c’est un piège vis-à-vis duquel nous avons à être particulièrement vigilants, car l’autre ne vit pas notre vie à notre place et ne remplit pas la même fonction d’autorité que nous.
Le manager équilibré est celui qui a compris que dans une relation interpersonnelle, chacun des deux est 100% responsable de ce qui se passe à l’intérieur de lui (son ressenti) comme de ce qui émane de lui (ses paroles et ses actes.)
Certains managers croyant avoir compris cela, se veulent rassurants et aidants.
Et c’est mon deuxième point : le manager qui fait des remarques audibles mais nuisibles.
Cette cadre de santé bien intentionnée accepte de fermer quelques instants la porte de son bureau pour entendre les difficultés personnelles des membres de son équipe. Elle a compris que tant qu’une personne a quelque chose sur le cœur, il lui sera impossible de s’ouvrir et d’écouter sa demande à elle, que tant que la bouche ne s’est pas vidée, les oreilles restent hermétiquement closes. Elle se dit donc que si elle sait écouter, elle saura apaiser et en ceci elle raisonne juste. Mais il arrive souvent que sa manière de s’y prendre soit maladroite.
Une infirmière du service semble, depuis quelque temps, avoir des difficultés de concentration, elle a oublié une distribution de médicaments et, chose plus grave encore, elle a confondu, lors d’un pansement, les pathologies des patients. Sa cadre la convoque, espérant mettre un terme à ce qu’elle espère n’être dû qu’à une fatigue temporaire.
- Dites-moi, Nicole, qu’est-ce qui se passe depuis quelque temps, vous n’avez pas l’air bien ?
- Ah Madame, ça ne va pas du tout pour moi en ce moment, je n’en peux plus depuis que j’ai découvert que mon fils de 14 ans se drogue ! (Ici Nicole, se sentant écoutée, ose exprimer librement ses préoccupations.)
- Vous voulez parler de Julien, un garçon si sérieux, vous pouvez être certaine que ce n’est que temporaire !
- Je n’aurais jamais cru cela de lui, depuis que je l’ai appris, je ne dors plus…
- Vous savez, Julien est un jeune adolescent, il a dû être victime de l’influence d’un de ses camarades…
- Mais il se drogue, vous rendez-vous compte, Madame, il se drogue !
Depuis le début du dialogue, la cadre, prise entre son besoin de mettre un terme aux comportements maladroits de Nicole et la sensation de sa propre insécurité face à la révélation de Nicole (ne sachant pas comment la gérer) essaye de relativiser les faits et tente de la rassurer : un garçon si sérieux, cela ne peut certainement pas durer… De son point de vue à elle, elle pense bien faire. En fait elle n’a pas conscience qu’elle est en train de nier le ressenti de Nicole devant elle et plus le dialogue se poursuit, plus il devient un dialogue de sourds.
Nous avons tous tendance à le faire mais c’est une grossière erreur : rassurer est une attitude « violente » en ce qu’elle nie le ressenti de l’autre. Elle revient à dire « J’estime que vous avez tort de penser comme cela parce que de mon point de vue, je trouve que vous devriez penser ceci. »
Combien de fois ne nous sommes-nous pas trouvés confrontés au « tu n’as aucune raison de t’inquiéter » de l’autre, et avons-nous senti que notre interlocuteur ne comprenait pas nos difficultés ? En fait rassurer, c’est tenter de détruire la vérité de ce que vit l’autre ici et maintenant.
Bien sûr que telle n’est pas notre intention, mais c’est pourtant la manière dont nous sommes perçus par l’autre.
Certains sont compréhensifs d’une autre manière : ils tentent de trouver une solution aux problèmes de l’autre :
Mais Nicole, vous devriez aller avec lui consulter un psychothérapeute, j’en connais un très bien qui…
Ils ne s’occupent pas de savoir si l’idée même du psychothérapeute est accessible à cette femme (et encore moins à son fils !)
Toujours le diktat de mon point de vue à moi, toujours le « moi d’abord. » Moi je ferais cela donc c’est ce que vous devriez faire.
Comme rassurer, donner une solution à l’autre est une attitude « violente. » Celui qui expose son problème cherche à s’exprimer et en s’exprimant, il est en cours de résolution de son problème. Celui qui se précipite sur la solution, en la donnant à celui qui s’exprime, le coupe de son processus thérapeutique naturel[3].
Là encore, combien de fois ne nous sommes nous pas sentis frustrés par ces amis au « t’as qu’à » au bord des lèvres. « T’as qu’à faire ceci, t’as qu’à lui répondre cela… » L’écoute, s’accommode bien peu de la solution. Comment pourrions-nous savoir ce qui est bon pour l’autre à sa place ?
Chercher à convaincre est toujours une attitude maladroite même si c’est « pour le bien de l’autre », tant que cet autre n’en est justement pas persuadé.
Chercher à convaincre, c’est voir le point de vue de l’autre comme une erreur. C’est oublier le droit à la différence, que par définition, l’autre est un autre et qu’il en sera toujours ainsi.
Pourquoi, alors, continuer à fonctionner de la sorte en « cassant » une relation de confiance dans laquelle l’autre commençait à se confier ? Parce que notre besoin est immense de nous débarrasser de ce qui nous fait peur en croyant avoir la solution pour que « ça » s’arrange.
Dans notre culture, nous vivons encore trop souvent dans le contexte binaire et manichéen du « ou c’est moi ou c’est l’autre »… Comme si, en dehors de tout rapport de force, deux points de vue ne pouvaient pas coexister.
La plupart d’entre nous sommes convaincus que communiquer c’est convaincre, à tel point que quand nous recevons le point de vue de l’autre et que nous ne sommes pas d’accord avec lui, la communication est difficile !
Il est vrai que les rapports humains (?) de notre société marchande, comme la manière dont nous subissons le joug de la publicité cherchent à nous persuader qu’il faut être le plus fort (avoir raison.) Les formations au marketing comme les formations au management argumentent dans ce sens : pour réussir, nous avons à être con-vain-cant[4] !
A tel point qu’il nous paraît impossible d’entendre et de comprendre l’autre, sans être personnellement d’accord avec lui, c’est-à-dire de la même sensibilité.
En fait, et c’est mon troisième point, plutôt que de tenter de réduire notre locuteur à nous-même (convaincre), nous avons la possibilité du partage, sur la base de la responsabilité de chacun. C’est – je l’espère – ce qui est enseigné dans les formations portant sur l’affirmation de soi et cela sous-entend la capacité pour celui qui est affirmé de connaître et d’exprimer clairement ses besoins, sans ignorer ceux des autres.
Pouvons-nous nous souvenir que nous n’avons pas besoin d’être d’accord avec l’autre pour accepter qu’il ait dit ce qu’il a dit et même pour le comprendre.
Dans un tel contexte, une nouvelle attitude s’ouvre devant nous qui – basée sur l’acceptation inconditionnelle de l’autre tel qu’il est – nous permettra de lui faire une remarque de telle manière qu’elle soit entendue.
Nous avons vu que l’attitude managériale qui consiste à exercer une pression constante sur son personnel, quitte à lui faire honte et à le menacer si son travail n’est pas impeccable, est invariablement source d’anxiété et de tension. Cela pourrit les rapports internes d’une équipe et surtout encourage les gens à dissimuler leurs erreurs tout en inhibant leur propension à la créativité.
Comment s’y prendre alors pour que l’autre entende ce que nous lui disons ?
Nous avons compris qu’il est de l’intérêt du manager d’aborder les problèmes de communication interpersonnels en termes de confiance et de coopération, et cela d’autant plus quand il lui arrive d’avoir à faire à des personnes qui ont tendance à se considérer comme des victimes.
Même s’il est généralement douloureux de s’entendre critiquer, la plupart des gens peuvent accepter des remarques faites sur une base d’authenticité, par un supérieur qui s’associe à eux afin de les aider à changer de comportement.
Si les règles sont données dès le départ d’une « communication vraie » (c’est-à-dire d’une communication basée sur la reconnaissance et la validation authentique des sentiments et des émotions, dans le contexte de la constatation objective de « ce qui est »), l’interlocuteur se sentira beaucoup plus impliqué parce que soutenu plutôt que contraint au stress et à la culpabilité.
Cela nous amène à évoquer notre façon de considérer l’erreur.
En ce qui concerne la gestion des établissements de santé, il apparaît évidemment essentiel que leur organisation soit faite de manière à protéger au maximum les malades des erreurs possibles.
Malheureusement, dans un contexte dans lequel l’aggravation de la maladie et même la mort du patient sont considérés comme des échecs, le risque majeur est d’avoir comme objectif le « zéro défaut », quitte à infliger aux professionnels de la santé une angoisse considérable, due à leurs lourdes responsabilités.
Ainsi, par sa nature déconnectée de la réalité (la maladie et la mort font partie de la vie), le système en arrive non seulement à créer de l’angoisse mais également à empêcher sa régulation.
Combien d’aides-soignantes ou d’infirmières ai-je rencontrées qui culpabilisaient d’une chute d’un patient âgé ou même d’un simple repas refusé. « Vous comprenez, il faut qu’il mange ! » entend-on dire très souvent.
Une enquête de l’INSEE de 1999 nous révèle que 15% des femmes actives de 18 à 39 ans ont des pathologies du système nerveux (maux de tête, angoisse, dépression), contre 40% chez les soignantes…
Et c’est dans les établissements de santé managés de façon « réaliste », par exemple une maison de retraite où chacun a compris le sens et la limite de son rôle et où des réunions régulières, avec pour objectif le désir de partager ce sens et ces limites, sont organisées, que l’on trouve le personnel le moins angoissé, le plus équilibré, donc le plus capable, par exemple, de faire face à la souffrance des soignés en commençant par oser sobrement la reconnaître en dehors de toute manifestation émotionnelle, ce qui est la condition préalable à la possibilité de la soulager.
Organiser des Groupes de Parole, des groupes de régulation dans lesquels chacun se sent libre d’exprimer ses craintes, sous-entend tacitement le risque pour chacun de commettre des erreurs. Et c’est parce que certains managers ont la maturité de reconnaître cette réalité que les erreurs commises ne sont pas refoulées et que les professionnels de la santé de ces établissements-là peuvent faire leur métier sans la peur et le stress que vivent la grande majorité de leurs collègues. Ces soignants « heureux » peuvent demander soutien et conseil, et accepter ainsi de dévoiler leur part d‘imperfection.
Trop souvent, en voulant être parfait, le système créé l’inverse de l’objectif de sa politique. Comme je l’ai déjà souligné, il entérine le refoulement et la dissimulation. Sa rigidité, censée le prémunir des erreurs, le rend inefficace et générateur d’angoisse.
Dans une équipe saine, le « tabou » ne doit pas être de faire une erreur mais de la dissimuler parce qu’une erreur dissimulée ne peut pas être rectifiée.
On pourrait dire que c’est justement parce que nous ne voulons pas d’erreurs qu’il est important de ne pas en avoir peur. Car il est une loi psychologique qui dit que tout ce dont nous avons peur prend du pouvoir sur nous, la peur nous empêchant d’accéder à la vérité des choses « telles qu’elles sont » donc à la capacité à y remédier.
Il s’agira donc avant tout de dédramatiser, de rendre les relations… humaines, ce qui serait – avouons-le – la moindre des choses pour ceux d’entre nous qui y prétendent, ceux qui travaillent dans les RH, les relations humaines !
Rendre les relations humaines, c’est donc commencer par oser dédramatiser l’erreur afin de pouvoir la corriger… le plus rapidement possible.
Dédramatiser l’erreur c’est permettre à celui qui l’a commise de la considérer en dehors de toute implication émotionnelle liée au refus de l’avoir commise, c’est-à-dire au jugement qui culpabilise. Pour en être capable, il faut que nous-mêmes – responsables – n’en ayons pas peur, que nous puissions envisager l’erreur de l’autre autrement que comme un danger pour nous : le seul remède est la compréhension de l’autre.
Les managers, contraints par leur propre angoisse de ne pas avoir suffisamment d’autorité, sont inefficaces et maladroits, en premier lieu pour eux-mêmes. Ils ne voient pas qu’otages de leurs propres besoins, incapables d’affirmer leur manière de voir ou de ressentir dans la reconnaissance et le respect du point de vue de l’autre, ils risquent fort de s’y prendre de telle manière que l’autre – lui aussi, souvent prisonnier de son incapacité à s’ouvrir – ne pourra souvent pas réagir autrement que dans l’agressivité et la révolte.
Non pas : « Il est inadmissible qu’une fois encore vous ayez répondu agressivement à un patient », mais plutôt, par exemple : « Je comprends que votre énervement, dû aux difficultés que vous vivez actuellement, vous ait fait répondre agressivement à ce patient difficile. » (Enoncé compréhensif et objectif).
Et c’est cette compréhension qui permettra à ce soignant d’entendre la suite du propos : « Mais cela me contrarie parce que j’ai besoin de pouvoir compter sur vous. » (Conséquence sur le cadre de santé qui parle et s’expose avec authenticité).
En fait, l’attitude de base du manager communicant est de toujours commencer par valider son interlocuteur, c’est-à-dire lui faire sentir qu’il a compris que quelle que soit la manière dont ce dernier a agi, il a agi comme cela parce qu’il avait une raison valable pour lui d’agir ainsi. A l’inverse de l’attitude du manager maladroit qui consiste à juger immédiatement son interlocuteur en lui disant qu’il a eu tort (d’avoir agi comme il a agi.)
Souvenons-nous que si cette aide-soignante a eu le comportement qu’elle a eu, c’est qu’au moment où elle l’a eu, elle n’a pas pu se comporter différemment, compte tenu de ce qu’elle est, c’est-à-dire compte tenu de son histoire personnelle, ce qui revient à dire que le manager n’a pas d’autre choix que celui de faire « avec » son employé « tel qu’il est. »
L’être humain est à chaque instant le produit de ce qu’il a été, des diverses influences qu’il a reçues. Tout notre être est mémoire et nous sommes constitués de tous « ceux » que nous avons été depuis que nous existons. Si nous sommes capables de sourire, c’est parce que le sourire fait partie de notre « bagage », si nous sommes agressif, c’est parce qu’au moment où nous le sommes, des forces convergent en nous qui nous empêchent d’être autrement qu’agressif. Nous ne sommes évidemment pas réductibles à cela mais si nous voulons évoluer, nous sommes obligés de le reconnaître, c’est-à-dire de partir de cette réalité-là.
Si je me mets en tête de penser que le comportement de l’autre est inacceptable parce que – selon moi – il n’a pas de raison d’être ce qu’il est, j’empêche toute possibilité de communication entre lui et moi et par là même toute possibilité d’écoute et d’évolution de nos rapports.
La réalité dit que ce qui est intolérable pour moi, dans mon rôle de manager – ici le fait que cette aide-soignante ait répondu agressivement – s’est bel et bien passé. C’est donc sur la base de la sobre reconnaissance de ce qui s’est passé que nous pourrons – ensemble – espérer obtenir, dans le futur, un comportement plus adapté aux besoins du service et des patients.
Tenter de convaincre l’autre qu’il n’avait pas de raison d’agir comme il a agi est toujours maladroit et inopportun (comme nous l’avons amplement développé) parce que cela n’a pas de réalité, c’est même la principale cause de tension entre les personnes. Cela ne peut faire naître chez l’autre qu’un sentiment de non compréhension donc d’injustice. A l’inverse, reconnaître la raison pour laquelle l’autre s’est comporté comme il l’a fait et le lui dire, c’est valider le sens de ses actes et créer chez lui une détente qui lui permettra de se sentir en cohérence avec ce qu’il a été.
Il ne s’agit pas d’excuser celui qui a momentanément « failli ». L’excuse est souvent malsaine parce qu’elle déresponsabilise en démobilisant. Nous ne sommes pas dans un tribunal : pas d’avocat pour excuser, pas de juge pour culpabiliser, juste des faits et des raisons subjectives qui ont été la cause de ces faits.
Valider la raison pour laquelle l’autre a agi, c’est pouvoir le comprendre, donc valider sa responsabilité : « Compte tenu du fait que vous étiez stressée et en colère, je comprends que vous ayez répondu sur ce ton à cette pensionnaire. » Cela n’engage en rien le futur, ça a été vrai pour lui (ou elle) à ce moment-là et la cohérence de sa logique interne permet sa responsabilité puisque c’est bien lui (elle) qui a répondu sur ce ton à cette personne.
Puisque j’accepte sa logique (non pas comme une excuse mais comme la cause objective de son comportement), nous allons voir ensemble comment il serait possible d’agir sur les causes afin que nous ne nous retrouvions plus exposés aux effets. « Comment puis-je vous aider à vous détendre – compte tenu de ce que vous vivez en ce moment – afin que nous ne risquions plus d’exposer nos malades à des comportements qu’ensemble nous ne voulons pas. »
C’est sur la base de cette détente, de cette cohérence, que le manager pourra faire une demande à son collaborateur, demande qui aura de grandes chances d’être prise en compte. Parce qu’il se sentira compris, ce collaborateur sera d’accord pour tout mettre en œuvre afin de faire évoluer son comportement inapproprié.
Nous pourrions appeler une telle pédagogie de la relation, une « communication vraie », une communication qui donne à l’autre toutes les chances de se situer, grâce à :
- La compréhension chaleureuse de la logique interne de celui à qui nous nous adressons. (Chacun se sent à l’aise dans une communication qui se fait sur la base du respect de ce qu’il a été, et des raisons pour lesquelles il l’a été.)
- La constatation objective (c’est-à-dire non émotionnelle) de « ce qui est. » (Le flou de la généralisation et la manipulation, parler sur l’autre avec un jugement de valeur, seront évités, au profit d’un énoncé objectif donc non dramatisé.)
En résumé, nous pourrions dire qu’il est préférable de construire sur la base de ce que nos collaborateurs ont de meilleur plutôt que d’ébranler leur confiance en critiquant ce qu’ils ont de moins bon.
Car si l’autre, bien souvent, rejette l’observation qui lui est adressée, c’est simplement parce qu’il est incapable d’intégrer ce qui lui apparaît comme trop douloureux.
Dans la formation que j’anime « Management et Communication Vraie » qui permet à des responsables de réfléchir et de s’entraîner à la pratique sur ces thèmes, une cadre de santé s’est écriée lors de l’évaluation, « c’est une formation qui permet à ceux qui la suivent d’être bons. »
En fait, même si nous ne pouvons ambitionner de réussir ce que nous voulons que sur la base de la bienveillance avec nous-même et avec les autres, il s’agit moins de devoir être bons que de se donner les moyens de réussir ce que l’on veut.
Ainsi Brigitte, (cadre de santé dans un service de gériatrie) veut faire remarquer à Thérèse (aide-soignante), qu’elle devrait répartir avec plus d’équité son temps entre tous les malades :
« Thérèse, je sais que vous voulez bien faire, que la relation et l’écoute font partie de votre tache, et que ce n’est pas facile de résister aux demandes relationnelles de certains malades. »
Elle comprend son point de vue, sa manière de faire et elle les valide, c’est-à-dire qu’elle lui montre qu’elle les comprend. A ce stade, elle écoute ce que Thérèse a peut-être à lui dire à ce propos, toujours prête à se remettre en cause dès qu’elle envisage qu’un aspect de la réalité de l’autre pourrait lui échapper.
« Oui, c’est pas facile pour moi en ce moment, depuis que Madame X s’est cassé le col du fémur, elle est en demande constante d’une présence que j’aimerais pouvoir lui donner », pourra, par exemple, répondre Thérèse.
A ce niveau, il s’agira à nouveau pour Brigitte de valider la raison de Thérèse en lui montrant qu’elle la comprend.
« Je comprends en effet que cela soit difficile pour vous, en ce moment où Madame X vous demande peut-être plus que ce que vous pouvez lui donner dans le cadre de votre rôle. »
Ici, de deux choses l’une, ou Thérèse a quelque chose de plus à dire, auquel cas Brigitte (qui sait manager avec bienveillance) continuera de l’écouter (et de la comprendre en validant ce qu’elle dit), ou Thérèse a bien reçu les propos de Brigitte et attend la suite. Le principal critère permettant à Brigitte de savoir où en est la communication étant son ressenti de la détente de Thérèse. Elle pourra donc, à un moment, poursuivre :
« J’attire votre attention sur le fait que lorsque, comme en ce moment, vous n’êtes plus que deux dans le service – si vous restez plus de 10 minutes à écouter Madame X ou un autre malade, vous ne pourrez pas faire autrement que de prendre du retard au détriment de l’ensemble des malades du service et de vos collègues. »
Ici, Brigitte fait une description des conséquences probables, avant de clairement poser sa demande.
« J’aimerais que vous soyez particulièrement vigilante à ne pas risquer de devoir consacrer à certains patients un temps que vous seriez obligé de retirer à d’autres. »
Peut-être qu’à partir de cette demande, Thérèse aura quelque observation à faire de son point de vue à elle, auquel cas il s’agira pour Brigitte de continuer à rester à l’écoute pour tenir au mieux son rôle de manager bienveillant qui ne perd de vue ni son interlocutrice ni son rôle.
Pour terminer, quelques exemples concrets :
Que se serait-il passé, selon vous, si Brigitte s’était adressée à Thérèse en ces termes :
« Dites-moi, Thérèse, j’ai remarqué que vous restiez beaucoup trop longtemps dans la chambre de certains malades, apprenez à gérer votre temps ! » ?
Ou si alors qu’une infirmière arrivait, hors d’elle, dans son bureau en disant : « Ca fait 3 fois de suite que Monsieur Z arrache ses perfusions, je n’en peux plus ! » elle lui avait répondu : Ecoutez, calmez-vous, vous travaillez dans un service de toxicologie depuis 5 ans, vous devriez savoir comment vous y prendre avec ce type de patients ! » plutôt que : « Si c’est la 3ème fois, je comprends que vous soyez en colère ! Asseyez-vous et racontez-moi ce qui se passe… »
Et comme la cadre de santé a validé, reconnu la colère de l’infirmière, ensemble elles ont pu examiner la situation calmement.
Pour pouvoir nous entraîner à cette manière d’entrer en relation avec nos collaborateurs, il nous reste à devenir capable de différencier l’acte de son auteur, le comportement de la personne de son être profond.
La colère de cette infirmière n’est que l’expression de son comportement du moment, cette femme n’est pas la colère. Nous pourrions dire que son être profond est momentanément voilé par une émotion de colère. Comme toute émotion, sa colère est mesurable, elle est venue et elle partira. Par contre la valeur de cette femme – en tant qu’être humain – est non mesurable parce qu’infinie.
Serons-nous capable de nous souvenir que dans nos relations interpersonnelles, nous nous adressons toujours à des êtres humains, jamais à des comportements ou à des émotions ?
La juste autorité vis à vis de l’autre – celle qui se vit comme une présence sécurisante – et qui n’a rien à voir avec la domination et le désir de punir (qui n’est que de l’autoritarisme) passe donc par la capacité à s’adresser à lui sur la base de ce qu’il pourra entendre et accepter, en se souvenant que l’autre ne pourra nous accueillir que parce qu’il se sera senti préalablement entendu et compris.
On pourrait considérer cela comme une forme de politesse, comme de « frapper avant d’entrer. »
Allons-nous frapper à la porte de celui que nous savons indisponible ? Ou allons-nous attendre qu’il soit disponible ? Ou même l’aider à le devenir ? Cela dépendra de l’intensité de notre besoin, direz-vous. Mais même avec un besoin intense, la fin justifierait-elle les moyens ? Serait-il à notre avantage de brusquer la relation en risquant de blesser l’autre et de le voir se refermer alors que, justement, sa collaboration nous est si précieuse ?
Peut-être qu’après avoir lu ce papier, vous vous direz que tout cela est bien compliqué et qu’il est beaucoup plus simple de ne pas « prendre de gants » avec l’autre… A moins que vous ne vouliez, pour votre service, un absentéisme minimum et des personnes heureuses de venir travailler parce qu’elles savent que même si le travail est dur – et il est souvent très dur – elles peuvent compter sur une ouverture et une solidarité de leur cadre bienveillant, basée sur une communication vraie.
Notes :
[1] Voir à ce sujet mon article « Comment gérer celui qui dit du mal de nous ? Sommes-nous volontairement méchants ? » sur https://www.evolute.fr/connaissance-soi/gerer-dire-du-mal
[2] L’effet contraire en pédagogie dit que d’obliger quelqu’un à faire ce que l’on veut qu’il fasse est le meilleur moyen pour qu’il ne le fasse pas ou qu’il le sabote.
[3] Voir à ce sujet mon diaporama « Histoire du papillon » sur : https://www.evolute.fr/videos-diapos/histoire-papillon
[4] Quand on ne nous reproche pas d’être insuffisamment po-si-tif, voir à ce sujet mon article : https://www.evolute.fr/connaissance-soi/travail-pensees
© 2014 Renaud PERRONNET Tous droits réservés.
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article (11 pages) au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger la fiche pratique de formation :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
3 603 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)