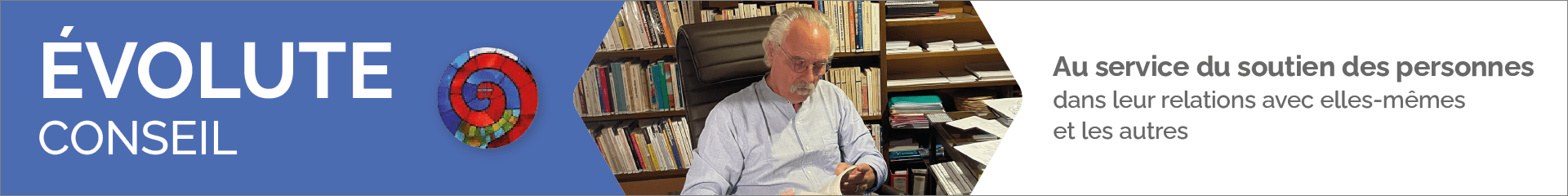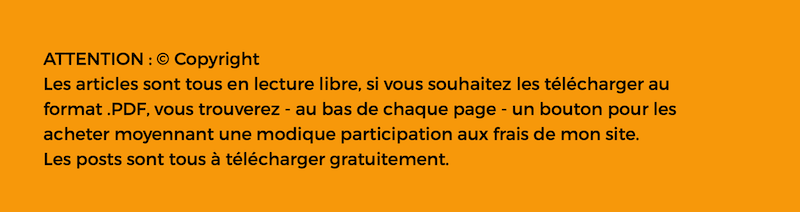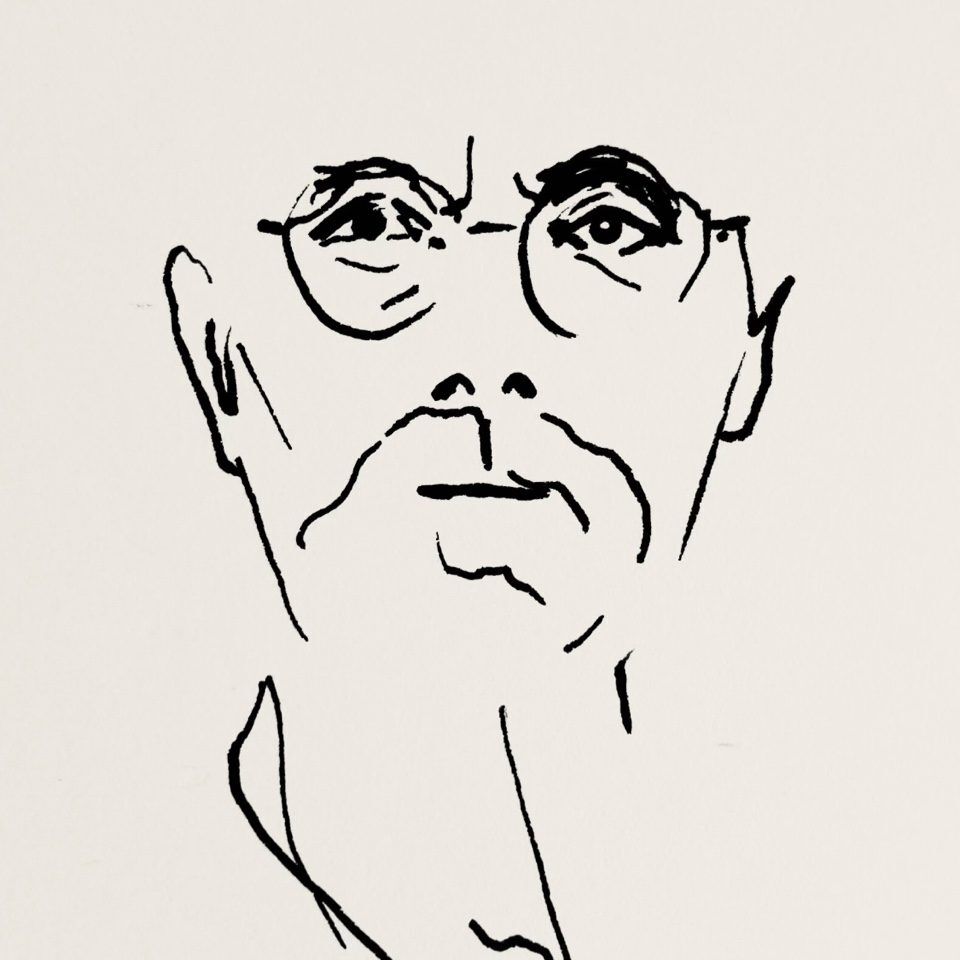ou comment entrer en relation vraie avec soi-même et les autres…
« Quand un homme a confiance en lui, il a le sentiment d’être ce qu’il est. « Je n’attends pas de moi davantage que ce que je suis capable de faire. J’ai fait ce que je pouvais. Je suis ce que je suis. Ce que les autres disent ne me touche pas. » Rappelez-vous : ne vous analysez pas en termes de « bien » et de « mal », analysez-vous plutôt en termes de « vérité » et de « réalité ». Ce qui est bien ou mal change en fonction du lieu, du moment, des personnes. Mais ce qui est vrai est stable comme le soleil. »
Swami Prajnanpad, Les Yeux ouverts
« Tout ce que l’on a à faire est de se démasquer, si pénible que cela soit ! »
Chogyam Trungpa, Pratique De la voie tibétaine
Le drame est un genre théâtral dont l’action généralement tendue, est faite de risques et de catastrophes. Dans notre vie quotidienne, le terme « drame » désigne une situation grave et tragique qui peut nuire à nos relations avec nous-même et avec les autres.
Dans la théorie de l’Analyse Transactionnelle on parle de jeux psychologiques destructeurs qui créent nécessairement un malaise entre les personnes. Pour les décrire Stephen B. Karpman a créé ce qu’il a appelé le Triangle Dramatique, à chaque extrémité duquel se trouve un rôle spécifique : Victime, Sauveur ou Persécuteur.
|
Pour comprendre le fonctionnement de ce triangle et mieux vous connaître à son propos, cliquez sur : Le Jeu de la victime |
La spécificité de ces trois rôles est qu’ils sont à la fois en interaction et interchangeables. Ainsi la Victime (qui cherche à se justifier), évoluera avec facilité en Sauveur (j’ai essayé de t’aider), ou en Persécuteur (tu ne m’aides pas), en fonction du comportement de son interlocuteur, lui-même prisonnier de ces mêmes rôles dictés par ses besoins frustrés issus de ses blessures passées.
La spécificité de ce Triangle Dramatique, également appelé Triangle SVP (pour Sauveur/Victime/Persécuteur) est qu’il est une prison de laquelle il est impossible de s’échapper une fois entré. La seule façon d’en sortir est de comprendre comment nous nous laissons piéger dans les jeux psychologiques que l’autre nous tend.
Le titre du livre de Guy Corneau, Victime Des autres, bourreau de soi-même, est révélateur. Celui qui se laisse « emmener » par lui-même ou par l’autre, par exemple parce qu’il veut paraître ce qu’il n’est pas, parce qu’il ressent le besoin de nier le comportement qui vient d’être le sien, ou parce qu’il ressent le besoin de convaincre l’autre qu’il doit être ce qu’il veut qu’il soit, ne peut que se perdre en devenant le jouet d’une mutuelle interaction dans laquelle chacun est inconsciemment victime de ses propres jeux et de ceux des autres.
La Victime exclusivement préoccupée par sa propre souffrance, se prive de ses ressources. Elle croit à tort que sa souffrance, à laquelle elle s’identifie, lui donne le droit de se plaindre, tout en s’empêchant de ressentir pleinement ses émotions.
Le Sauveur, quant à lui, est principalement préoccupé par les autres, mais d’une manière très égocentrique. En pensant à la place des autres, il néglige ses propres besoins. L’importance qu’il accorde à ce qu’il prend pour ses responsabilités le pousse à en faire toujours plus.
Le Persécuteur agit uniquement dans son intérêt propre, négligeant ainsi les sentiments des autres et utilisant son pouvoir contre eux.
Ceux qui, au lieu de ressentir leurs propres sentiments authentiques tels que la joie, la peur, la tristesse ou la colère, se laissent prendre dans les jeux psychologiques SVP (liés à la peur d’être soi-même et à la croyance qu’il faut tenir un rôle vis-à-vis des autres), se perdent et se condamnent à l’impasse dans leurs relations avec eux-mêmes et avec les autres.
Le drame que nous vivons est celui de passer à côté de notre vie, ce qui nous conduit à l’angoisse de mourir sans avoir véritablement vécu.
Les personnes qui ne se respectent pas dans leur être se perdent, incapables de trouver un équilibre entre elles-mêmes et les autres. Leur croyance en la nécessité de se soumettre aux autres les conduit, par réaction, à chercher à les dominer ou à vouloir les sauver. Divisées, confuses et souffrantes, elles sont incapables de s’appuyer sur elles-mêmes et sur leurs sentiments pour déterminer ce qu’elles veulent.
Comme le disait le maître tibétain Chogyam Trungpa : « Penser qu’il suffit de se fier à ce qu’on nous a dit de faire et négliger de se fier à ce que l’on ressent peut créer d’énormes problèmes. Si quelqu’un se contente d’obéir à ce qu’on lui a dit, son comportement risque de ressembler à celui d’un automate. Ce qu’il ressent n’a pas d’importance. Voilà comment on devient grossier. En réalité, on s’acharne à devenir un parfait acteur plutôt que quelqu’un de vrai. »
Pour vivre pleinement et établir des relations authentiques avec les autres, nous devons d’abord reconnaître les quatre nécessités fondamentales qui nous sont inhérentes en tant qu’êtres vivants :
- Ressentir ses sentiments en les vivant
- Exprimer ses sentiments en les partageant
- Poser des limites aux autres
- Exprimer ses besoins
- Ressentir ses sentiments en les vivant
Le plus souvent, nous ne nous rendons compte de ce qui s’est vraiment passé dans notre relation aux autres que longtemps après être sortis du moment de la relation.
Il nous faut du recul pour réaliser que nous avons pu blesser quelqu’un ou agir injustement. De même, nous ne reconnaissons souvent nos propres émotions, comme la colère ou la tristesse, qu’après coup.
En prenant conscience après coup de ce qui s’est vraiment passé dans notre relation aux autres ou à nous-même, nous pouvons nous apercevoir que nous nous sommes éloignés de notre sensibilité et que nous n’avons le plus souvent pas conscience de nos sentiments profonds. D’où l’importance d’apprendre à écouter notre corps pour ressentir pleinement les sentiments qui sont les nôtres. Notre pensée est limitée à elle-même, mais avec notre corps, du moins si nous ne le mettons pas en doute, nous ne pouvons pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas nier ce que nous ressentons – pour autant que nous osons pleinement le ressentir. Cependant, pour beaucoup, ressentir n’est pas une priorité mais plutôt une menace.
Baudelaire a écrit : « Ne méprisez la sensibilité de personne ; la sensibilité de chacun, c’est son génie. » Notre sensibilité est d’autant plus notre génie qu’elle nous permet de nous orienter finement dans l’existence. Conditionnés que nous sommes à raisonner et à nous confronter aux autres avec la tête, nous en oublions notre capacité à connaître les choses et les êtres à travers notre simple ressenti corporel.
Par exemple, nous avons tellement entendu dire qu’il ne fallait pas pleurer, que les larmes étaient une faiblesse, que beaucoup d’entre nous répriment leurs larmes sous le mauvais prétexte de ne pas paraître trop sensibles.
Se mettre à l’écoute de sa sensibilité est d’autant plus essentiel que cela revient à explorer sa spécificité, ce que Baudelaire appelle son génie propre. Cela commence par apprendre à accepter ses propres sensations corporelles, comme ses propres sentiments. Il nous faudra pour cela nous confronter à notre peur d’affronter des ressentis qui nous apparaissent d’autant plus irrationnels qu’ils sont imprévisibles.
Pratiquer in petto la formule « ici et maintenant je suis ce que je suis, je sens ce que je sens, et je ne suis rien d’autre » ; se rendre à cette évidence en la vivant de l’intérieur au moyen de notre corps nous y aide. Oser sentir, avec notre corps, que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes, par exemple, toujours légitimes à rencontrer et laisser s’exprimer notre colère à l’intérieur de nous-même et c’est très libérateur pour des êtres à qui on a si souvent fait le reproche qu’ils ne devaient pas être comme ils étaient. Pour ce faire, pour apprendre à ressentir les choses, il suffit de s’arrêter d’agir, même de bouger, et de revenir à l’intérieur de soi avec une intention claire, là où les pensées n’ont aucune prise : je suis ce que je suis et c’est tout.
C’est dans nos ressentis que se trouve tapie la spécificité de notre relation à la vie. C’est là que se trouve notre force qui détermine la façon dont nous allons nous animer. Cette alchimie qui détermine la vitalité propre à chacun à travers un ancrage du corps nous permet de connaître le monde mais aussi de nous exprimer, de nous développer et de nous perpétuer.
Apprendre à se rencontrer et à rencontrer les autres, c’est accepter de ressentir ses sentiments, comme les leurs, même lorsqu’ils nous semblent confus et désordonnés. C’est oser les accueillir en nous, en nous livrant à nos propres sensations. Le phénoménologue Merleau-Ponty écrit : « C’est par mon corps que je comprends autrui, comme c’est par mon corps que je perçois des « choses. »
Nos premiers pas vers cette découverte consistent à avoir confiance en notre capacité à ressentir les sentiments qui sont les nôtres pour les accueillir : colère, joie, peur, tristesse, mais aussi sentiment d’injustice, humiliation, trahison, impuissance, abandon, culpabilité, rejet…
Comme le dit poétiquement Rûmi :
« Chaque hôte, quel qu’il soit,
Traite-le avec respect,
Peut-être te prépare-t-il
À de nouveaux ravissements.
Les pensées noires, la honte, la malveillance,
Rencontre-les à la porte en riant
Et invite-les à entrer. »
Les inviter à entrer, c’est bien sûr ne pas les nier mais surtout s’y exposer pour chercher à mieux se connaître en ayant compris qu’on ne peut agir que sur ce que l’on connaît.
- Exprimer ses sentiments en les partageant
Les autres et moi sommes nécessairement des êtres différents. « L’autre est un autre », répétait Swami Prajnanpad. Cela signifie que lorsque je ressens quelque chose face à l’autre, l’autre ne le sait pas encore. Si je le garde pour moi, je l’enferme à l’intérieur de moi, rien ne se passe. Si je le communique à l’autre, je sors de ma coquille et fais – à coup sûr – bouger la relation. Je participe alors activement à l’élaboration d’un processus créateur qui met en branle le devenir de la relation. Je participe ainsi activement au processus de la vie.
« L’autre est mon aventure. Prendre le risque de l’autre », disait Yvan Amar. Partager ses sentiments c’est prendre un risque, le risque qu’ils ne soient ni entendus ni compris par l’autre, le risque de l’étonnement, du désaccord, de la réprobation, donc le risque de la souffrance.
Dans la relation, nous situons-nous comme libres ou comme assujettis ? Que voulons-nous vraiment ? Un consensus illusoire fondé sur la peur du partage et la crispation, ou une confrontation à l’autre franche et vivante permise par la révélation de soi ?
Sans doute ne pouvons-nous pas nous sentir libres avec n’importe qui. Mais sommes-nous d’accord pour l’être avec un nombre limité de personnes avec lesquelles nous partagerons notre désir d’authenticité et notre capacité à être vrais ?
Vivre c’est oser sortir de sa prison, oser sortir de son hypocrisie pour devenir vrai. Ne pas prendre ce risque dans nos relations, c’est dépérir en s’étouffant à petit feu.
Je décide de ne plus participer plus aux jeux psychologiques auxquels je ne consens pas. Je ne me mets par exemple plus dans la position du gentil sauveur avec ma compagne qui me demande de l’accompagner faire une course si je n’en ai pas envie. Je m’efforce activement de sortir de mon hypocrisie à lui laisser croire que de l’accompagner me fait plaisir, même si cela signifie décevoir sa demande.
Cette approche a mené à des révélations et à des mises au point rafraîchissantes dans les couples. Je ne cherche plus à séduire, car la relation à l’autre est trop importante pour moi. Je ne veux plus l’entretenir dans sa routine et sa tartufferie. En aspirant à l’authenticité, je prends le risque que l’autre ne me comprenne pas d’emblée. À moi de lui expliquer posément les raisons de ma nouvelle façon de faire avec lui.
- Oser poser des limites
La véritable raison pour laquelle beaucoup d’entre nous hésitent à poser des limites est la peur de perdre en prenant des risques. Si nous avons peur de perdre, cela signifie que nous ne sommes pas de vrais joueurs, que nous ne sommes pas prêts à nous engager pleinement dans le jeu relationnel. Imaginez un skieur qui a peur de glisser ou un nageur qui a peur de se mettre à l’eau. Ces personnes pourraient-elles être considérées comme des skieurs ou des nageurs ?
Inconscients que nous sommes de la dualité des choses, esclaves de nos peurs, nous souhaitons que nos vœux se réalisent en même temps que nous refusons de prendre le risque qu’ils ne se réalisent pas. C’est ainsi que nous faisons perdurer notre souffrance en nous acharnant à refuser ce qui est nécessairement inévitable.
Comme le dit Aragon :
« Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare. »
Nous faisons semblant d’ignorer que si le soleil brille aujourd’hui, il y a chaque jour davantage de chances pour qu’il pleuve demain, et que si nous sommes en bonne santé, nous tomberons inévitablement malades un jour. En refusant d’accepter la totalité de la vie, nous nous condamnons à souffrir lorsque nous sommes confrontés à des circonstances qui ne nous conviennent pas. Nous nous plaignons et nous lamentons, incapables d’assumer nos responsabilités. Nous nous trouvons des excuses pour tout et vivons comme des infirmes inadaptés. Des infirmes qui, refusant constamment leur infirmité en la trouvant injuste, se condamneraient à la trouver éternellement injuste, et deviendraient incapables d’en faire jamais le deuil.
Ceux qui se laissent guider par la peur de perdre s’empêchent de vivre pleinement. Ils se rétrécissent, s’étiolent et se ratatinent. Comme le dit le proverbe, la chance sourit aux audacieux. L’audace devrait être la devise de ceux qui ont peur de vivre pleinement leur vie, car à se plaindre, ils ne font que perpétuer leur souffrance – et celle de leurs proches.
Dans un tel contexte, il est crucial pour notre équilibre de savoir poser des limites aux autres. Cela implique de se porter garant de soi-même et de parvenir à une clarté quant à ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas. Ceux qui sont clairs sur leurs désirs peuvent accepter ce qu’ils ne veulent pas dans certaines conditions.
Celui qui pose une limite claire aux autres ne cherche pas à être consensuel ou sympathique. Il s’assume tout en sachant que les choses ne se passeront pas toujours comme il le souhaite. On appelle cela être clair avec soi-même et les autres, et c’est une vertu assez rare.
« Maman, je t’ai déjà dit que si tu me téléphones pour critiquer l’homme avec lequel j’ai choisi de vivre, je n’ai plus aucune envie de poursuivre notre conversation. Soit tu cesses tes critiques sur lui, soit je raccroche. »
Plutôt que de courir le risque de vous plaindre à votre entourage de votre mère parce qu’elle ne respecte pas vos limites, agissez conséquemment avec ce que vous vous sentez de faire. Ne pas se laisser marchander, ne pas transiger avec ce que l’on ressent, c’est s’assumer.
Si nous faisons les choses par devoir, il y a toutes les chances pour que nous le fassions payer à notre entourage. Comme par exemple cette femme qui détestait faire la cuisine et s’obligeait à la faire depuis des années, imposant par là-même constamment sa mauvaise humeur à l’ensemble de la famille. Un jour – résolue à être vraie et authentique – elle annonça que c’était fini, qu’elle ne consentirait plus à être la cuisinière de tous et qu’elle ne ferait que les tâches pour lesquelles elle aurait un vrai désir de les faire. Après quelques semaines, libérée de la contrainte, s’étant elle-même régulée sur la base exclusive de ce qu’elle consentait à faire, de l’avis de tous, elle était devenue souriante et affable, alors même qu’elle participait à d’autres travaux ménagers. Une personne qui est en paix avec les raisons pour lesquelles elle agit comme elle agit met son énergie au service de la vie et agit en harmonie avec elle.
Poser sa limite peut être assez exigeant pour une personne qui a l’habitude de se poser en victime, mais cela vaut la peine d’en faire l’expérience parce que c’est le moyen que nous avons tous à notre disposition pour nous entrainer à devenir adulte. Ceci ne concerne pas les enfants qui n’ont pas de limites parce qu’ils n’ont aucune connaissance d’eux-mêmes, ils sont immatures. Un adulte, lui, s’il fait confiance à son ressenti qui lui dit la limite au-delà de laquelle il ne peut pas aller, peut l’exprimer à l’autre. En cela, il ne fait qu’obéir à lui-même, à son ressenti.
L’idée masochiste selon laquelle nous devrions souffrir pour plaire aux autres est particulièrement détestable parce qu’elle transforme ceux qui s’y assujettissent en victimes prêtes à mordre à la moindre occasion.
Par exemple, si votre compagnon vous propose d’aller au cinéma un soir, et que vous vous sentez fatiguée, exprimez votre limite clairement, faites ce qui est en votre pouvoir pour qu’elle soit entendue, soyez sincère et vraie, pas de chantage ni de manipulation, c’est là la condition du respect et de l’équilibre dans votre couple.
Ne mettriez-vous pas la limite à votre enfant de deux ans qui se pencherait de la fenêtre du troisième étage ? Pourquoi n’oseriez-vous pas mettre une limite à ce qui vous apparaît comme injuste, à ce dont vous vous sentez ici et maintenant incapable ? « Il faut que tu comprennes que je ne veux plus ça. Tel(le) que je suis aujourd’hui, tel(le) que je me sens en ce moment, c’est non, voilà ! » Cela vous évitera de devoir vous sentir mal, de faire grandir en vous le ressentiment contre l’autre, parce que vous vous êtes conduit(e) en victime consentante. « Je ne veux plus que tu te comportes ainsi avec moi, c’est comme ça. »
Surtout, en posant vos limites, vous vous montrez visible pour l’autre, vous lui donnez toutes les chances de savoir à quoi s’en tenir, vous le respectez et vous évitez toute interprétation erronée de sa part car vous êtes sans équivoque. Poser ses limites c’est assumer une communication transparente avec soi-même, et avec autrui en lui exprimant ses sentiments.
En posant vos limites, vous faciliterez la pose de ses propres limites à votre partenaire, vous saurez ainsi tous deux à quoi vous en tenir, vous initierez ainsi une relation adulte/adulte. L’autre pourra réagir, dire qu’il est d’accord par exemple ou, s’il ne l’est pas, se dévoiler à son tour clairement. Pourra s’ensuivre, au besoin, une saine et vraie dispute. Qui a dit que la dispute ne devrait pas exister dans une relation ? Quel bisounours oserait soutenir que dans un monde dans lequel les oppositions sont constantes, les accrochages ne devraient pas exister ? Je parle là de la vraie dispute – saine – de celle qui ne tourne pas en rond mais met les choses vraiment sur la table, de celle qui est une opportunité pour aller plus loin et trouver un accord. Une relation réelle, qui ne se perd pas dans un idéalisme illusoire passe par la dispute et ne débouche pas sur la rupture, à la condition du respect des limites de chacun et d’une bonne dose de conscience pour éviter de prononcer des paroles irrécupérables.
- Exprimer ses besoins
Nos besoins infantiles que l’autre soit à la mesure de nos désirs sont comblés lorsque ses comportements nous satisfont. Nous pensons même parfois que si l’autre nous aimait, il ne pourrait que remarquer ce dont nous avons besoin.
C’est là une idée fausse profondément enracinée dans les relations interpersonnelles : « Tu ne vas pas me faire croire que s’il m’aimait vraiment il n’aurait pas oublié mon anniversaire ! Je suis certain(e) qu’il (elle) ne m’aime plus, il (elle) n’est même pas conscient(e) de mes besoins ! »
Dans notre narcissisme, nous sommes tous plus ou moins convaincus que l’autre devrait sans cesse nous deviner. C’est là nier notre unicité, notre différence, et le fait que chacun est d’abord occupé par lui-même.
Cette formule de reproche : « Si tu m’aimais vraiment tu saurais me deviner », si nous sommes parvenus à ne pas la dire, nous l’avons tous au moins pensée.
Plutôt que de dire en toute transparence : « Tu sais, je reviens d’une journée de travail harassante, j’ai besoin que tu me laisses seul(e) et tranquille pendant vingt minutes, je reviendrai vers toi après », nous nous ingénions à dissimuler notre vérité. En même temps, nous grimaçons en pensant que l’autre devrait savoir, voir que nous ne sommes pas disponibles. Nous nous interrogeons sur sa prétendue insensibilité ou sur la preuve, que nous pensons flagrante, de son non-amour à notre égard.
Le moyen le plus efficace de faire comprendre à quelqu’un que nous ne sommes par exemple pas disponibles est de le lui dire clairement. Seulement nous ne voulons pas avoir l’air, soumis à notre esclavage, incapables de nous assumer par rapport à ce que nous voulons vraiment, nous faisons mine de nous adapter au désir de l’autre au mépris de nos besoins.
Or nous n’avons pas besoin que l’autre soit gentil avec nous, nous avons d’abord besoin qu’il soit vrai, et la règle humaine des relations c’est de comprendre que le meilleur moyen pour nous de recevoir ce dont nous avons besoin c’est de nous en occuper en commençant par l’exprimer clairement.
Bien qu’il puisse exister des moments de grâce dans nos relations, des moments magiques pour nous où l’autre semble capable de lire dans nos pensées, il est crucial de donner la priorité à la satisfaction de nos propres besoins.
Si vous avez besoin d’aide, d’amitié ou de tendresse, ou si vous souhaitez que quelqu’un vous fasse un gâteau, vous écoute ou vous prenne dans ses bras, l’important est de le lui dire, plutôt que de vous attendre à ce qu’il le devine.
Dans le même temps, être adulte c’est se souvenir que l’autre est un autre, qu’il a donc le droit de surseoir à notre demande ou de ne pas y répondre. Celui qui demande doit être prêt à ne pas recevoir ce qu’il demande puisque personne n’appartient à personne et que personne n’est l’esclave de personne.
Par exemple si vous demandez : « J’ai besoin que tu m’écoutes, » chacun est légitime à répondre : « Je suis désolé(e), j’ai une grosse journée de travail derrière moi, ce n’est pas le moment pour moi de t’écouter. » C’est à ce niveau, à ce moment précis que se vit et se joue la relation. Il y a là dans la pièce deux adultes qui expriment chacun leurs besoins respectifs et qui découvrent que ces besoins sont temporairement irréconciliables. Deux adultes sont capables de se rencontrer pour entendre et considérer leur différence, donc de ne pas la nier, au contraire de deux enfants qui ne le peuvent pas, parce qu’ils sont immatures donc manipulés par l’intensité de leurs besoins respectifs.
Souvent nous n’osons pas exprimer nos besoins (de la même manière que nous n’osons pas mettre des limites), nous nous auto-censurons par peur que nos besoins ne soient pas entendus. Pourtant, c’est précisément en osant les exprimer que nous augmentons nos chances d’être écoutés. Notre peur agit comme un censeur, tandis que notre courage à exprimer clairement nos besoins devient notre allié, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Lorsque nous nous adressons à l’autre avec une sincérité palpable, nous avons plus de chances de le convaincre et de le faire changer d’avis, même face à nos craintes.
Cette petite fille de 9 ans savait depuis toujours qu’il était hors de question d’avoir un chien à la maison, son père s’y étant toujours opposé. Un jour son père apprit qu’elle avait allumé une bougie dans une chapelle tibétaine et fait un vœu. Intrigué, il lui demanda de partager l’objet de son vœu. Après réflexion elle lui révéla qu’elle avait fait le vœu d’obtenir ce qui lui ferait le plus plaisir au monde et que ce serait d’avoir un petit chien à elle. Moins d’un mois plus tard son père avait exaucé son vœu. Que s’était-il passé ? Son père s’était ouvert à son besoin parce qu’il avait été capable de l’entendre alors qu’auparavant, il avait toujours opposé son désir au sien. Le comportement de sa fille lui avait montré l’importance de son désir, qui confinait au besoin. Le père réalisa clairement que c’était son désir contre celui de sa fille et il choisit de satisfaire celui de sa fille, par amour pour elle.
Cette petite histoire illustre que lorsque nous osons exprimer nos véritables désirs, même lorsque nous pensons qu’ils sont irréalisables, des opportunités inattendues peuvent se présenter. La petite fille fut stupéfaite car elle ne s’attendait pas à un tel cadeau. Cela confirme l’existence de moments de grâce dans la vie, où les choses peuvent changer si nous nous ouvrons à nos propres besoins.
Nous sommes souvent confrontés à nos pensées limitantes sur nous-mêmes, nos conceptions et nos idées sur le monde et les autres. Beaucoup de ces obstacles existent uniquement dans nos têtes et non dans la réalité. Pour le découvrir, nous devons oser les affronter en faisant confiance à notre intuition, à ce que nous ressentons. Notre capacité à défier les situations de nos vies peut provoquer des réactions inattendues chez les autres, les rendant plus ouverts.
En nous entraînant à nous libérer de la peur constante du refus, nous cessons d’être soumis à la déception. Nous aurons tenté, et si nous échouons – ce qui est potentiellement possible – nous pourrons nous dire qu’au moins nous avons osé demander. Ne nous perdons pas dans la confusion, ne laissons pas notre besoin de réussite ou notre peur de l’échec nous empêcher de poursuivre ce que nous ressentons comme nécessaire et digne de nous. Comme le disait Swami Prajnanpad : « La dignité veut dire : « Oui, je suis quelque chose, je suis quelqu’un et j’éprouve une nécessité, j’ai une mission – si vous aimez les grands mots -, quelque chose à faire, et sans faire cela, ma vie n’est rien, aussi je ne peux que le faire. »
Dans un monde en perpétuel changement, nous cherchons quelque chose de stable, une référence fixe. Cependant, vivre signifie être constamment projeté dans l’incertitude. C’est en embrassant cette incertitude et en nous laissant surprendre par elle que nous devenons plus forts et plus intrépides.
Il nous faut tout prendre de nous-mêmes, car le sens que nous pouvons donner à notre vie réside dans notre capacité à être à la fois authentiquement et simplement ce que nous sommes.
Lorsque nous nous libérons du besoin d’être reconnus et admirés par les autres, de nombreuses possibilités s’offrent à nous, des possibilités qui nous seraient restées inaccessibles si nous étions restés repliés sur nous-mêmes. En conséquence, et comme l’exprime Chogyam Trungpa : « Tout ce que l’on a à faire est de se démasquer, si pénible que cela soit ! »
© 2025 Renaud Perronnet. Tous droits réservés.
Pour aller plus loin sur ces thèmes, vous pouvez lire :
- Ressentiment ou responsabilité
- Oser la colère, oser être vrai avec soi-même
- Faut-il et peut-on aider par devoir ?
- Se défaire de l’attachement pathogène à ses parents
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article de 10 pages au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
809 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)