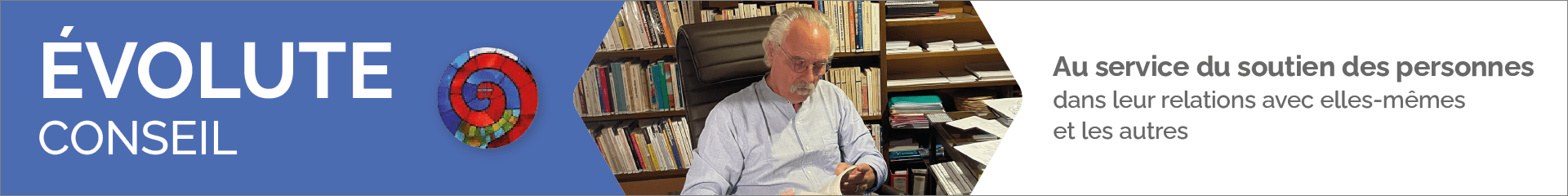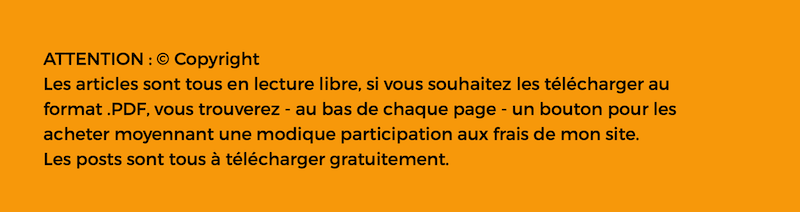Faut-il apprendre à « mettre de la distance » dans la relation d’aide ?
« Vous n’échapperez jamais à ce dont vous n’avez pas la connaissance réelle. C’est une certitude. Comment pouvez-vous être libres d’un ennemi, d’un danger, d’une prison que vous ne connaissez pas ? C’est la Connaissance qui donne la maîtrise et la liberté. »
Arnaud Desjardins.
Le mois dernier, par le biais de l’espace « Poser une question » de mon site internet, je reçois ce courriel désemparé :
« Je suis infirmière en réanimation depuis 8 mois environ, diplômée depuis 2 ans.
Je suis tombée sur votre site en recherchant sur internet des conseils sur comment prendre du recul par rapport aux situations que je vis au travail.
J’ai beaucoup de mal à « laisser les problèmes au boulot » comme on dit… Pour vous donner un exemple : j’ai pris en charge une jeune fille de 19 ans qui est décédée d’une méningite et j’ai souffert d’un torticolis pendant un mois, je savais que c’était lié…
J’ai beaucoup de mal à accepter les décès des personnes dont je me suis occupée. Alors on me dit qu’il faut m’endurcir mais je ne me vois pas faire ce travail avec un cœur de pierre !
En plus de ça je me sens coupable parce que je suis de plus en plus agressive envers mon ami, en fait je me défoule un peu sur lui !…
Je crois tout simplement que j’aurai besoin d’en parler mais je ne sais pas vers qui me tourner…
Si vous avez un conseil à me donner, il sera le bienvenu, sinon cela m’aura quand même fait du bien d’exprimer ce qui me pèse sur le cœur par écrit… Merci. »
Quelques jours plus tard, cet autre message désespéré :
« Infirmière depuis près de 20 ans dont 3 ans en long séjour, je suis en arrêt pour dépression nerveuse depuis 2 mois suite au burn-out selon mon médecin (je n’ai plus rien à donner, je suis vidée, je ne supporte plus de voir souffrir, ni mourir), peut-on s’en sortir et comment, car pour le moment, ma seule solution est de tout arrêter… »
Au cours de leurs études et de leurs formations, les instructeurs des différents types d’aidants (éducateurs, soignants, assistantes sociales, psychologues) se sentent justifiés d’insister sur la nécessité de mettre de la distance, pour l’aidant, entre lui-même et « l’aidé ».
La plupart des jeunes infirmières se voient prodiguer ce genre de conseils par leurs ainés : « Tu ne devrais pas t’investir autant », ou encore la simple prédiction négative (et manipulatrice) : « Tu verras, tu ne pourras pas tenir longtemps en continuant ainsi », qui laisse le plus souvent les novices mal à l’aise et dubitatives quant à leur rôle.
En groupe de formation, j’entends souvent des aidants concéder : « C’est vrai, au début je m’impliquais trop, aujourd’hui, j’ai appris à mettre de la distance, à faire en sorte que les choses ne me touchent plus autant, j’ai appris à m’endurcir. »
Un directeur de Maison de Retraite me disait récemment : « Plus la fin de la vie de Madame X – qui se meurt d’un cancer du foie avec blocage biliaire – approche, plus les aides-soignantes de ma maison s’investissent auprès d’elles et plus je les sens déprimer. Il faut absolument qu’elles apprennent à mettre de la distance ! »
Dans un Groupe de Parole que j’anime, un Conseiller à l’Emploi partageait : « Il faut absolument que je parvienne à mettre de la distance vis-à-vis de personnes au vécu aussi dramatique, sinon je n’ai plus qu’à changer de boulot ! »
Pourquoi les aidants croient-ils devoir mettre de la distance ?
Il est vrai que le premier souci de l’aidant doit être de se préserver lui-même car s’il ne le fait pas, il risque de devenir une victime dans sa relation à l’autre.
Si l’espèce humaine a réussi à se préserver, c’est certainement parce qu’elle fonctionne communément de cette manière basique : elle s’éloigne de ce qu’elle considère comme un danger, donc de ce qui lui fait peur. La mise à distance est donc le moyen premier que nous employons vis-à-vis de ce que nous craignons.
Regardons de plus près de quoi l’aidant a peur.
Comme le dit si bien cette élève infirmière en train de mourir, dans sa lettre désormais célèbre(1) : « Pourquoi avez-vous peur ? Après tout, c’est moi qui meurs ! »
N’est-ce pas la personne âgée, atteinte d’un cancer du foie avec blocage biliaire , qui se meurt, alors de quoi les aides-soignantes du service ont-elles peur ?
Ce n’est pas le Conseiller à l’Emploi qui vit aujourd’hui la situation dramatique du chômage mais la personne assise en face de lui.
Pourquoi avons-nous peur à la place de l’autre ?
Une aide-soignante, rencontrée à l’occasion d’une formation sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, nous met sur la voie : « Comment voulez-vous que j’ose me confronter à la douleur de cette famille qui vient de perdre sa vieille mère quand le simple souvenir de la mort de la mienne me remplit de terreur ? »
Nous découvrons donc que quand un être humain se retrouve face à une situation ou un événement qui lui rappelle un vécu personnel traumatisant, il ne peut pas faire autrement que de le craindre pour lui-même, même s’il n’est pas, ici et maintenant, mis en cause.
Parce que notre développement, depuis l’enfance, se fait par cristallisation autour d’impressions emmagasinées dans l’inconscient, nos souvenirs traumatisants nous obligent à agir en nous protégeant afin d’apaiser une souffrance insupportable.
Parce que la douleur de cette famille rappelle au psychisme de cette aide-soignante un souvenir personnel trop douloureux, elle ne peut pas agir autrement qu’en tentant de toutes ses forces de l’éviter.
Ainsi, l’aidant en proie au malaise est animé par une confusion des rôles qui l’amène à redouter pour lui, ce qui arrive à l’autre.
Parfois, cette confusion des rôles amène l’aidant à penser qu’il doit faire pour l’aidé ce qui ne fait pas partie de sa tâche propre… comme cette aide-soignante qui emporte régulièrement chez elle pour le laver, le linge sale d’une pensionnaire seule au monde plutôt que d’alerter sa Surveillante du problème. Incapable de voir la limite de son rôle, « prenant sur elle » c’est-à-dire « prenant contre elle », elle s’oblige (contrainte par son idéal de « bonne » soignante) à faire ce qu’elle se reproche de n’avoir pas fait pour sa grand-mère, par exemple.
Cette confusion des rôles fait que certains aidants ne peuvent pas vivre autre chose que de la pitié pour l’aidé.
Ainsi ce psychologue de ma connaissance qui, après beaucoup d’hésitations, décide d’aller rendre visite à sa collègue, victime d’une attaque cérébrale et totalement paralysée dans son lit. Prenant son courage à deux mains (en fait, tentant d’agir contre sa peur), il se rend à l’hôpital pour découvrir qu’il lui est impossible de pousser la porte de la chambre de sa collègue malade et qu’il ne peut que rebrousser chemin.
Poussé par son émotion de pitié (qui le faisait souffrir de l’état de sa collègue), ce psychologue a pensé qu’il devait être capable d’aller la soutenir dans une situation aussi dramatique. (La pitié est une émotion négative parce qu’elle nous fait agir non pas en harmonie avec nous-même mais contraint, là encore, par notre idéal.) Il a donc couru à l’échec et s’en est voulu (culpabilité) de n’être pas conforme à l’image qu’il avait de lui et de ce dont devait être, à ses yeux, capable un psychologue.
Or ce n’est ni de souffrir de l’état de l’aidé, ni de culpabiliser de ses incapacités temporaires qui nous aidera à aider ! Souffrir de la souffrance de l’autre ne rajoutera que de la souffrance à la souffrance et rendra notamment l’aidant dépendant de son besoin de s’en protéger.
Une fois encore, la confusion des rôles animée par les « bons sentiments » (je dois être à la hauteur…) empêche celui qui veut aider de le faire.
D’ailleurs, l’élève infirmière en train de mourir(1) dont nous parlions plus haut poursuit : « Ne nous disait-on pas, dans les cours de psychologie, que si on approche la pathologie du mourant avec sa propre pathologie, cela ne peut que nuire à la relation d’accompagnement ? Et que pour pouvoir être au clair avec l’autre, il faut connaître ses propres sentiments ? »
Ceci dit, la plupart des aidants, font par devoir, ou comme ils peuvent, avec la souffrance et la mort mais ils en « crèvent », et soit se réfugient dans la dépression, soit décident de s’endurcir en se convainquant qu’il leur faut prendre de la distance vis-à-vis de ceux qu’ils se proposent d’aider.
La prise de distance est la solution que croit avoir trouvée l’aidant qui ne sait quoi faire d’autre pour se protéger d’une relation qui lui fait peur, soit parce qu’il redoute l’état de l’autre pour lui-même, soit parce qu’il se sent en porte à faux dans la relation (honte, culpabilité.)
Incapable d’imaginer un autre comportement, il pratique la politique de l’autruche. Un peu comme une mère qui, se sentant démunie devant les hurlements de son bébé, fermerait la porte de sa chambre et se réfugierait dans le salon pour ne plus l’entendre. (C’est parfois ce qui se passe dans les services de gériatrie !)
La mise à distance dans la relation d’aide est le sauve-qui-peut de l’aidant qui va peu à peu se blinder au point de ne plus avoir la sensibilité suffisante pour être capable de discerner l’opportunité de ses interventions.
C’est vrai que j’entends souvent dire de la part des personnes qui gèrent mal leur sensibilité qu’elles auraient rêvé d’être moins sensibles. Elles croient pouvoir fermer les vannes de leur sensibilité en parlant fort, regardant peu la personne qu’elles sont censées aider, et surtout en ne l’écoutant pas vraiment. En mettant de la distance, elles ne sont bien sûr pas en mesure de lui répondre de manière juste(2). Comme telle infirmière qui, ne pouvant pas s’ouvrir à la peine d’une personne âgée lui confiant en pleurant qu’elle aimerait voir son fils aîné, a cru pouvoir la consoler en lui disant de penser aux enfants de sa fille qui sont « si mignons ». A votre avis, la vieille dame s’est-elle sentie comprise et a-t-elle été réconfortée ?
« Loin des yeux, loin du cœur », dit-on, la prise de distance endurcit. Avec beaucoup de sensibilité, la jeune infirmière qui m’a écrit pressent le piège en exprimant : « Je ne me vois pas faire ce travail avec un cœur de pierre ! »
La mise à distance, même si elle le protège momentanément, ne peut que frustrer l’aidant – qui s’éloigne en même temps de ce qui l’a poussé à vouloir consacrer sa vie professionnelle à s’occuper de ceux qui souffrent. Comment en effet concilier le « souci de l’autre », le fait de s’impliquer suffisamment pour aider et la nécessité de se préserver pour ne pas se perdre ?
Peut-on encore parler de relation d’aide lorsque l’aidant ne s’implique qu’avec réticence ?
Une interview du Dalaï Lama(3) me revient en mémoire : « Il m’est arrivé de rencontrer des médecins qui travaillaient derrière d’énormes machines en n’éprouvant apparemment aucune émotion humaine ; ça fait une drôle d’impression. Ces praticiens avaient peut-être de grandes capacités professionnelles, mais ils ne m’inspiraient aucune confiance. »
Et peut-on aller mieux si on n’a pas confiance dans la personne qui vous soigne ou vous accompagne ?
J’en appelle à l’expérience de chacun d’entre nous. Il vous est sans doute arrivé de rencontrer des médecins pour lesquels vous n’étiez visiblement qu’une pathologie à soigner et qui ne croyaient pas devoir prendre l’être humain en considération.
« D’expérience, je me sens mieux soigné par un médecin souriant, qui s’intéresse à mon cas en toute sincérité. » poursuit le Dalaï Lama (3) .
La relation d’aide demande donc,pour exister, l’authenticité et la sincérité de celui qui l’entreprend, car ce sont ces qualités qui permettent en retour la nécessaire confiance de l’aidé sans laquelle aucune aide ne peut aboutir.
Comment alors ne plus courir le risque de se perdre dans la relation à l’autre ?
Il est dangereux (pour nous comme pour ceux que nous prétendons aider) d’entrer en relation d’aide sans s’y être préalablement préparé ; le drame est que certains aidants, la « tête bien pleine » de connaissances théoriques et techniques, découvrent leurs malaises sur le tas, en situation d’aide. Là, en proie à la peur (quand ils veulent bien la reconnaître), ils n’ont pas d’autre recours que de céder à la prise de distance, en se convainquant eux-mêmes qu’ils doivent moins s’investir personnellement.
Or c’est une lapalissade, la mise à distance… éloigne !
Pour ne plus devoir se blinder, pour ne plus devoir mettre de la distance entre l’aidé et nous, nous avons besoin d’apprendre à entrer en relation d’aide.
Ce n’est certes pas le fruit du hasard si la formation que j’anime depuis plus de 15 ans sur le thème de l’accompagnement des mourants s’intitule « Se préparer à accompagner les mourants », et qu’on y pratique un certain nombre d’exercices dont celui de nous situer personnellement par rapport à notre propre mort ou celui de faire le « bilan de ses propres valeurs ». Car l’un des objectifs exprimés de cette formation est de permettre à ceux qui y participent de commencer de répondre à certaines de leurs interrogations sur la mort comme d’engager un processus de réconciliation avec leur propre crainte de la mort.
Accompagner la vie d’une personne jusqu’à sa mort, écouter une femme (ou un homme) en proie au désespoir d’avoir perdu celui qu’elle aime, accueillir un adolescent au bord du suicide ou recevoir la colère d’un salarié victime d’une injustice n’est possible pour un humain aidant que parce qu’il a fait lui-même le plus gros du travail avec ses propres émotions(4).
Sinon, de même que l’aidé non accueilli par l’aidant souffre, l’aidant non accueilli par lui-même est en proie au mal-être qu’il projettera en retour sur l’aidé.
Comment travailler sur ses émotions ?
La première chose à établir est que, quelle que soit l’émotion, si elle est là, nous ne pouvons que composer avec elle. Parce que nous n’avons pas le pouvoir qu’elle ne soit pas là, donc que nous ne pouvons pas l’éliminer, il nous reste comme seule possibilité de faire « avec ».
« Faire avec » c’est devenir capable de ne pas rajouter un refus (je ne devrais pas ressentir ce que je ressens) donc une émotion à l’émotion première (ce que je sens).
Prenons l’exemple de Béatrice, une infirmière qui est particulièrement touchée par le drame d’Hervé, 14 ans, atteint d’un cancer des os, qui a été successivement amputé du pied droit, de la jambe et maintenant de la hanche et pour qui le pronostic est très sombre parce que des métastases envahissent presque tous ses organes principaux.
Une nuit, après un sondage vésical, Hervé lui demande : « Tue-moi cette nuit pendant qu’il n’y a personne. »
- Premier cas de figure : l’identification inconsciente.
Béatrice, (qui ne se connaît pas) ne sait pas que si elle est littéralement terrorisée par la demande d’Hervé, au point de ranger rapidement le matériel et de sortir discrètement de sa chambre sans avoir dit un mot, c’est parce qu’elle l’associe à ce qu’elle redoute le plus personnellement : une souffrance telle qu’elle engendre une demande d’euthanasie. Elle n’a pas conscience que cette demande réveille en elle le formidable malaise qu’elle a vécu à 6 ans en secondant sa mère auprès de son grand-père qui criait toutes les nuits et suppliait qu’on mette fin à ses souffrances atroces.
Elle est donc la victime de ce qu’elle n’a pas reconnu en elle et qui est actif (tant qu’il n’est pas reconnu !)
Pire, elle rajoutera une difficulté à sa difficulté, une souffrance à sa souffrance, une émotion à son émotion : convaincue que la demande d’euthanasie d’un enfant de 14 ans est nécessairement horrible (parce que c’est ce qu’elle craint le plus) donc incapable d’y faire face, elle s’en voudra de son incapacité à être à la hauteur de la relation d’aide qui lui est demandée. Condamnée à la fuite, elle sombrera dans la mauvaise conscience et la culpabilité.
Cette situation est banale et habituelle. Quand elle se répète jour après jour et année après année (ce qui est souvent le cas), elle mène l’aidant au burn-out.
- Second cas de figure : l’acceptation de soi et de ses limites.
Béatrice (qui se connaît, donc qui connaît les principales causes de ses émotions parce qu’elle les a étudiées) sait que si elle est tellement affectée par la demande d’euthanasie de cet enfant, c’est parce qu’elle l’associe à la mort douloureuse de son grand-père (à une époque de sa vie où elle était impuissante).
Elle se sert alors de la connaissance qu’elle a d’elle-même comme d’une force en ce sens qu’elle ne nie pas ce qui lui fait si peur et lui rappelle une telle souffrance (elle ne rajoute pas un refus à son émotion), elle s’y ouvre, s’appuie dessus et tente de toute sa force d’accepter sa limite : « Ici maintenant, je suis ce que je suis, et il n’y a rien d’autre » (ce qui, je me permets de vous le rappeler, ne laisse rien présager du futur).
La connaissance de soi permet d’être en contact avec la réalité de ce qui est dans l’instant, donc de ne plus avoir besoin de nos interprétations (c’est trop horrible, cela ne devrait pas toucher des enfants) – qui sont à l’origine de nos émotions perturbatrices ultérieures.
Il est donc très important de garder à l’esprit que si nous ne pouvons rien faire pour stopper nos émotions premières, il est par contre en notre pouvoir d’agir pour éviter qu’elles ne durent en se multipliant. Il est donc possible (si nous nous donnons les moyens de l’accepter) de laisser l’émotion perturbatrice simplement se dissoudre.
Béatrice donc, ayant accepté le jaillissement de sa mémoire et n’y surajoutant aucun refus pourra répondre « en aidante » à la demande de la situation en disant, par exemple, à Hervé : « Je sens qu’on a besoin de parler tous les deux… », elle pourra écouter ce qu’il a besoin de dire de sa peur – à lui – de souffrir et de mourir et cela lui permettra peut-être même de réparer un peu… en faisant avec Hervé ce qu’elle n’avait pas pu faire avec son grand-père.
Quand l’être humain n’est plus en contradiction, divisé contre lui-même, il devient naturellement capable de faire « ce qu’il faut » dans le cadre de son rôle(2), c’est-à-dire de ne plus devoir obéir à ses contradictions internes.
Je récapitule : le travail de base pour un aidant est de gérer (donc d’accepter) ses propres émotions pour qu’elles ne le troublent pas au point de l’empêcher d’aider.
L’aidant – au quotidien – se retrouve confronté aux émotions des autres, il ne peut gérer cette confrontation avec bonheur que parce qu’il a appris à gérer ses propres émotions, sinon, il se perd dans celles des autres qu’il confond avec les siennes.
L’idée selon laquelle il est souhaitable de « mettre de la distance psychologique » dans la relation d’aide est donc un faux semblant et un leurre, un mensonge à soi-même, parce qu’en mettant cette distance nous ne faisons que conforter le malaise émotionnel qui nous la fait mettre. Un peu comme un enfant qui se raconte à lui-même qu’il n’a pas peur… alors qu’il tremble de peur.
Pour nous comme pour les autres, seul « l’accueil de l’émotion telle qu’elle est » est « aidant ». Pour garder l’équilibre et ne pas sombrer dans le burn-out, l’aidant doit apprendre à accueillir la vérité de ce qu’il vit, de ce qu’il sent, sans rien dissimuler, pour devenir capable d’accueillir ce que vit et sent l’aidé.
Tant que l’aidant vivra sa pratique professionnelle dans la crainte et la confusion des rôles (identification donc oubli de l’altérité(5)), il ne pourra pas « être accueil » et se condamnera à plus ou moins rejeter l’aidé en s’en méfiant.
Parce que l’aidant vivra dans sa chair, c’est-à-dire au plus profond du ressenti qu’il a de lui-même, qu’il n’est pas l’aidé, donc qu’il est distinct de lui,il n’aura plus le besoin de mettre de la distance vis-à-vis de lui.
C’est parce qu’il n’y a plus de méprise ni de confusion possible entre l’aidant et l’aidé qu’une ouverture plus grande est possible.
L’aidant distinct de l’aidé n’a plus besoin d’être distant de lui.
Je redonne la parole à l’élève infirmière(1) en train de mourir :
« J’ai encore entre un et six mois à vivre, un an peut-être, mais personne n’aime aborder ce sujet. Je me trouve donc en face d’un mur qui est tout ce qui me reste. Personne ne veut voir le malade mourant en tant qu’être humain et par conséquent ne peut communiquer avec moi. »
Pourquoi les soignants ne veulent-ils pas voir le malade mourant comme un humain ? Parce qu’ils en ont peur. Pourquoi en ont-ils peur ? Parce qu’ils sont dans la confusion entre eux et lui. S’ils remettent les choses à leur place (Je suis moi, il est lui), ils vont pouvoir s’ouvrir au malade tel qu’il est.
Pour pouvoir communiquer avec l’aidé, il est nécessaire de le voir, de l’appréhender « tel qu’il est ». Si, sur un champ de bataille, la plaie d’un enfant – occasionnée par un obus – rend un secouriste trop mal à l’aise, il ne pourra pas le soigner.
Pour qu’il puisse soigner cet enfant, ce secouriste doit accepter, de tout son être, d’avoir été touché par lui, ce qui lui permettra de sentir qu’il n’est pas cet enfant blessé et, l’ayant senti (les rôles de chacun étant clairement délimités), de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider (distinct mais non distant).
Cette attitude d’acceptation lucide de l’aidé distinct permettra aux aidants :
- de ne plus avoir besoin de mettre de la distance,
- d’entrer dans une relation d’aide donc dans une relation humaine.
Je vous propose une définition simple de la relation aidante au niveau psychologique : « Aider l’autre, c’est lui permettre de détendre ses tensions. »
Pour permettre à l’aidé de se détendre, nous avons à lui montrer notre chaleur humaine, à nous intéresser à lui en toute sincérité. Cette fameuse lettre de l’ élève infirmière(1) en train de mourir le dit avec simplicité :
« Si nous pouvions seulement être honnêtes, admettre nos peurs, nous toucher mutuellement. Votre professionnalisme serait-il vraiment menacé si vous alliez jusqu’à pleurer avec moi ? Est-il vraiment exclu que nous communiquions vraiment pour qu’à l’heure où ce sera mon tour de mourir à l’hôpital, j’aie auprès de moi des amies ? »
Attention la confusion est sous roche… j’entends penser certains de mes lecteurs… « Alors si je comprends bien, il faut pleurer avec ceux qui pleurent… qu’allons-nous devenir ! Et puis pourquoi devrions-nous être les amis de ceux qui vont mourir ?! »
La principale qualité de l’aidant étant l’honnêteté, il n’est pas question de « jouer » avec l’aidé. Etre honnête, c’est oser être ce que l’on est.
Je m’explique : si en face de cette personne souffrante, vous n’éprouvez aucune émotion particulière, il n’y a aucun problème (le problème serait de penser devoir en ressentir une), ici maintenant, l’aidant ne peut aider que sur la base de ce qu’il est.
Mais si – par contre – en face de cette personne souffrante, vous éprouvez une émotion de tristesse par exemple, cela n’est pas un problème non plus (le problème serait de penser devoir la lui cacher), un aidant peut, bien sûr, être touché dans son humanité et s’il accepte d’être l’aidant qu’il est, il renverra à l’aidé une image congruente, conforme à ce qu’il est, par exemple celle d’un aidant momentanément en proie à la tristesse.
Souvenons-nous que ce ne sont pas nos émotions qui nous usent (en fait elles nous aident à vivre en nous permettant de gérer des situations) mais leur refus. L’émotion de tristesse devant l’aidé n’est pas le problème, le problème serait son refoulement à travers la honte de soi.
Sur le visage d’un aidant, touché par le vécu de l’aidé, une larme coule. Parce qu’il l’accepte, cette larme n’est pas un problème pour lui, elle peut même faire sentir à l’aidé combien son histoire l’a touché. Cela s’appelle la compassion, et c’est à ce moment que l’aidant et l’aidé sont « vrais » unis dans leur humanité.
Cette « relation vraie » permettra à l’aidé de se sentir accueilli, donc de pouvoir partager en retour ce qui lui est intime et le touche profondément.
La relation d’aide ne doit pas se conjuguer en termes de « il faut » mais en termes de « je peux »… alors j’y vais.
En fait – et peut-être contre toute attente – nos émotions d’aidants ne sont pas des obstacles à la relation d’aide car elles sont la part humaine à travers laquelle nous nous exprimons.
J’ai envie de partager avec vous cette interview du Dr. Baghded Sereir, médecin dans un service de cancérologie, que j’ai retranscrite à partir du film de Jean-Xavier de Lestrade « La vie jusqu’au bout (6) » :
Question du journaliste : Vous réagissez d’abord en tant qu’humain ou en tant que médecin ? Ou c’est la même chose ?
Le Dr. Sereir : Pas forcément, mais je ne pense pas que ce soit la même chose, comme je fonctionne, c’est en tant qu’humain d’abord. Ce que je pense primordial en fin de vie, c’est l’aspect humain qui prime sur tous les autres. C’est à partir de ce contact humain qu’on pourra mettre en place tout ce qui est secondaire et néanmoins trèsimportant, le côté technique, soulagement et accompagnement.
Le journaliste : Le fait de côtoyer la mort des autres vous a rendu plus humain ?
Le Dr. Sereir : Plus que ça, pas seulement humain dans le sens où on comprend et on essaye de remédier à la souffrance de l’autre, où on essaye d’apporter une certaine chaleur. C’est presque un honneur, d’être, de partager un certain nombre de choses, d’être accepté, à ce moment là par celui qui finit sa vie. Moi, j’ai appris ça en étant à côté des gens en fin de vie qui étaient débordants d’émotions, d’intelligence, de créativité. Et cette générosité qu’on nous donne une fois, fait qu’on laisse un petit peu la carapace tomber. »
Que se passera-t-il au moment où, plutôt que de la renforcer, nous oserons« laisser un petit peu la carapace tomber » ? Non, nous ne tomberons pas dans la dépression (j’espère vous avoir fait sentir que la dépression du burn-out est le résultat du refoulement de nos propres peurs), au contraire nous nous ouvrirons encore davantage, en ressentant au fond de nous que nous sommes des privilégiés de pouvoir travailler dans un tel contexte. Mais le Dr. Sereir le dit tellement mieux que moi :
Le journaliste : « A aucun moment vous n’avez imaginé partir d’ici, fuir cet endroit ?
Le Dr. Sereir : Non, au contraire. Non, pas du tout. Mais c’est vrai, quand on parle à des collègues, à ceux qui n’ont pas côtoyé ces maladies graves, ces fins de vie, c’est vrai qu’il y a une étape à franchir qui est celle-là. Accepter ses propres faiblesses, retrouver un équilibre avec soi-même pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. S’accepter déjà en tant que quelqu’un qui finira un jour et accepter la mort comme une fin pour nous tous. En fait, il faut avoir une certaine philosophie de la vie, et la mienne rejoint ce que je fais. Je ne me sens pas malheureux de faire ça. Au contraire, je pense que c’est une chance, c’est une chance de pouvoir faire ça. »
Je vous souhaite donc – à vous jeune infirmière qui avez partagé avec moi votre errance – de lui trouver un sens, c’est-à-dire de comprendre ce qui (en vous) vous entraînerait à devoir vous endurcir plutôt qu’à accepter les décès auxquels vous êtes confrontée car, je suis d’accord avec vous, il n’est pas possible de faire ce travail avec un cœur de pierre.
« Laisser les problèmes au boulot » n’est que le conseil simpliste de ceux qui, ne savent pas gérer les leurs. « Laisser les problèmes au boulot » n’est tout simplement pas possible car avoir un problème, c’est avoir quelque chose qui nous trotte dans la tête et, quand cela nous arrive, nous n’avons pas la possibilité, la liberté de le mettre de côté ! Par contre il est possible plutôt que de le laisser trotter dans notre tête, de nous y confronter afin de le voir comme inhérent à notre pratique, puis de l’accepter comme tel pour qu’enfin il se dissolve. C’est la confrontation à nos difficultés qui nous permettra de les résoudre, rien d’autre.
Comme nous l’avons vu, avec le cas Béatrice, c’est quand elle s’est confrontée à ses propres émotions, qu’elle a pu agir vraiment de manière juste en faisant sentir à Hervé qu’elle le comprenait.
Votre travail demande votre bonne volonté, votre honnêteté (notamment vis-à-vis de vos propres sentiments) et votre ouverture. Souvenez-vous que vos émotions – comme les émotions des autres – ne sont problématiques pour vous que parce que vous ne les acceptez pas : la difficulté ne réside donc pas dans vos conditions de travail (aussi dures soient-elles) mais en vous. Remarquez que c’est une bonne nouvelle car s’il n’est pas possible de changer ce qui n’est pas de notre ressort, il nous est possible d’évoluer, si nous le souhaitons vraiment.
Posez-vous la question de votre paradoxe : Qu’est-ce qui, dans mon histoire personnelle, fait – qu’ayant souhaité du fond de moi-même être infirmière (donc m’attendant à être confrontée à la souffrance et à la mort) – je me retrouve devant un si grand malaise, voire une impossibilité à accepter la mort de l’autre ?
Quand vous dites que vous savez que le déclenchement de votre torticolis était lié à votre refus de voir mourir une jeune fille de 19 ans, c’est très intéressant. Et si vous voulez – à l’avenir – ne plus avoir besoin de déclencher un torticolis, il faut aller voir plus profond en vous. D’où provient ce sentiment de révolte ? Comprenez bien que si vous souhaitez, dans le futur, être capable d’accompagner une (jeune) personne qui va mourir jusqu’à sa fin, vous devez comprendre ce qui vous en empêchait auparavant.
Il est également important que vous voyiez que vos réactions émotionnelles concernant votre entourage proche (votre ami) sont normales (tant que vous n’apprenez pas à gérer seule, ou avec un thérapeute bien choisi, votre malaise), même si je comprends que vous désireriez que cela se passe autrement.
Vous faites comme vous pouvez et vous en vouloir ne fait que rajouter une seconde émotion à une première émotion. Encore une fois gérer ses émotions (et la culpabilité en est une), c’est les intégrer et non pas les juger en les critiquant ce qui revient à les refouler.
Un mot encore, comme vous le dites si bien : « Je crois tout simplement que j’aurai besoin d’en parler. », je suis d’accord, là aussi, avec vous et c’est pour cela que le Groupe de Parole est si précieux(7) pour ceux qui travaillent dans un contexte professionnel potentiellement chargé en émotions !
A vous « infirmière depuis près de 20 ans », je souhaite que cette alerte, cette dépression, ce burn-out, vous aide à sentir qu’il est possible d’aider sans se perdre (notamment en comprenant comment vous vous y êtes prise pour vous perdre). C’est ce travail qu’à mon sens vous aurez à entreprendre si vous voulez aller au-delà de votre symptôme de dépression. Pourquoi la mort et la souffrance vous sont-elles devenues insupportables à vous ? Cela ne vous sera possible de le comprendre que sur la base du respect de ce que vous êtes et de ce que vous vivez.
Puissiez-vous être étonnée, bousculée par les propos du Dr. Sereir cités plus haut: « Je pense que c’est une chance, c’est une chance de pouvoir faire ça. » Non, ce médecin n’est ni fou ni inconscient, il avance comme il le peut, ici maintenant, en s’ouvrant à l’immensité de la souffrance à laquelle il est confronté. Cet homme a compris que son acceptation est le garant de sa capacité à aider et à soulager la souffrance de l’autre.
Puissent ses propos vous aider à retrouver espoir et confiance en vous.
Notes :
(1) Lettre d’une élève infirmière en train de mourir, voir la nouvelle et libre traduction, sur mon blog ICI.
(2) Voir mon article intitulé : « Réponses aidantes ou maladresses nuisibles ? ».
(3) Interview accordée par le Dalaï Lama à Fabien Ouaki, en 1996, pour son livre “La vie est à nous”.
(4) Voir les articles intitulés : « Voir ses schémas à l’œuvre pour y renoncer » et : « Comment devenir soi-même ? »
(5) Voir la réflexion sur l’attachement, au début de mon article intitulé : « Le travail de deuil ».
(6) Film de 65 mn, de Jean-Xavier de Lestrade, diffusé le 8 septembre 1998 sur France 3. Au Centre Médical Spécialisé en Cancérologie et en hématologie Praz-Coutant dans l’Isère, 500 patients sont traités par an. Certains, trop gravement atteints, y finissent leurs jours. C’est l’opportunité pour le réalisateur de poser des questions essentielles : Quelle attitude adopter face à celui qui va mourir ? Lorsque l’on est médecin ou parent proche comment affronter l’angoisse de celui qui va nous quitter ?Comment faire face à la mort lorsque l’on sait la sienne si imminente ? Un film lumineux sur l’accompagnement.
(7) Voir mes articles intitulés : « Le défi de l’aidant » et « Le Groupe de Parole et d’Analyse de la Pratique de la Relation d’Aide ».
© 2006 Renaud PERRONNET Tous droits réservés.
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article (11 pages) au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger les fiches pratiques inédites :
- 5 points pour être en harmonie avec soi-même et les autres
- Comment s’y prendre avec un aidé agressif ?
- Apprendre à se détendre
- La ligne de conduite de l’écoute
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
147 837 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)