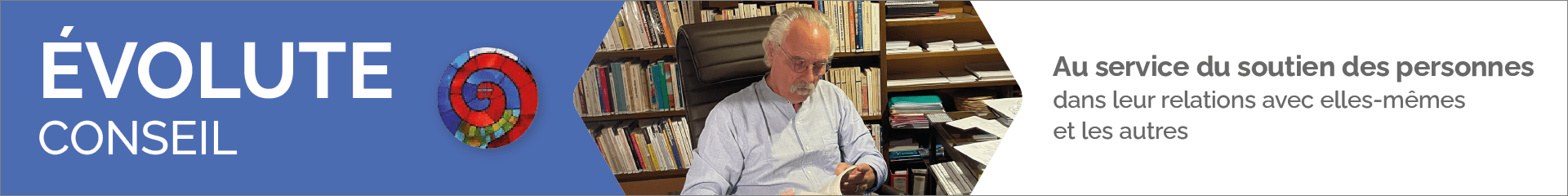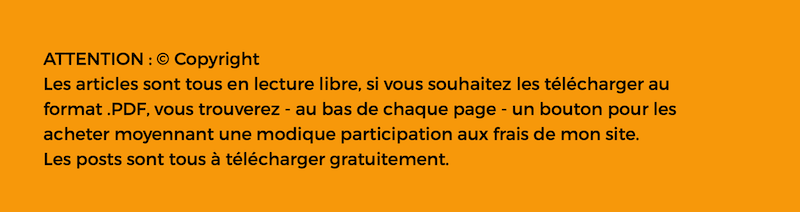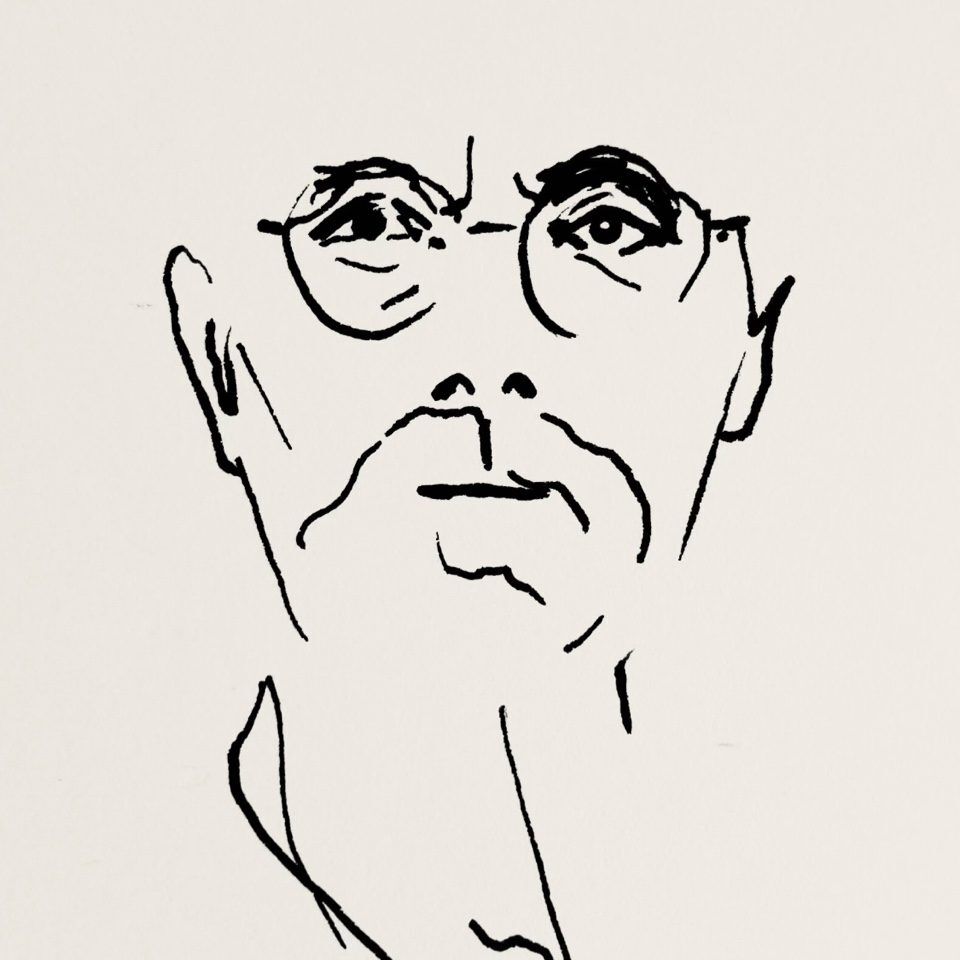« Tout apparaît et disparaît. C’est la caractéristique de la Nature : ce n’est qu’une simple manifestation ! Si « quelque chose » semble « se produire », cela ne veut pas dire que cela existe ; rien ne reste sous la même forme sans changer : le monde, c’est simplement le fait de changer, de bouger. Le monde n’arrête pas de bouger, et dans ce monde qui bouge, tout s’écoule, rien ne reste sous la même forme. Par conséquent aucune chose n’est, il n’y a que mouvement sans fin. Ce mouvement se manifeste comme apparition et disparition. »
Swami Prajnanpad
La « persona » (du latin per-sonare : parler à travers) désignait le masque porté par les acteurs de théâtre de l’antiquité. Ce masque avait pour fonction de leur donner l’apparence du personnage qu’ils interprétaient, permettant ainsi aux spectateurs de comprendre et de prédire leur action. La persona est donc un masque, une apparence.
Aujourd’hui, nous disons volontiers d’une personne qu’elle est « prévisible » quand son comportement correspond à son apparence et à notre jugement sur elle. Jung, en psychologie analytique, a adopté le terme « persona » pour désigner la manière dont un individu adopte un personnage socialement prédéfini dans ses interactions sociales.
Le terme « consensualité » est également fréquemment utilisé pour décrire une personne qui cherche à satisfaire la plupart des gens. Il implique l’idée de se conformer à des normes et des apparences sociales afin d’éviter de se montrer tel que l’on est, (donc de se réfugier derrière un masque), au risque d’être perçu comme transparent ou même hypocrite.
C’est précisément en raison de ce conditionnement que la psychologie moderne est de plus en plus capable de prévoir le comportement d’une personne avec une marge d’erreur limitée. C’est la raison pour laquelle, en 2001, la Gendarmerie nationale a créé un Groupe d’Analyse Comportementale, récemment rebaptisé Département des Sciences du Comportement1 (DSC) qui définit l’analyse comportementale comme un outil d’aide à l’enquête judiciaire en ce qu’il permet d’élaborer le profil d’un criminel.
On pourrait dire que la personnalité d’une personne est la somme de ses caractéristiques émotionnelles et comportementales, façonnées par son éducation. C’est un mélange de tempérament inné et de caractère acquis.
Les premières réflexions sur le lien entre les phénomènes mentaux et les comportements remontent à l’Égypte ancienne2. Au sens large, les débuts de la psychologie remontent donc à l’antiquité. Bien avant l’avènement de la psychologie moderne, des modèles de typologies de la personnalité ont émergé à travers diverses approches telles que l’astrologie, la numérologie et l’ennéagramme. Aujourd’hui, les principaux courants de la psychologie moderne utilisent également des typologies de personnalité à travers les fameux « tests de personnalité ». Ces tests évaluent la somme des traits d’un individu, qui découlent à la fois de son tempérament et de son caractère.
Plus récemment, les chercheurs se sont intéressés aux bases biologiques de la personnalité en étudiant la relation entre la structure du cerveau et divers comportements psychologiques. Ils ont – par exemple – découvert comment les hormones sécrétées par un individu peuvent influencer sa personnalité. Par exemple, ils ont découvert que la testostérone est une hormone, associée au désir sexuel, à la sociabilité et à l’agressivité.
Dans son sens le plus large, on dit d’une personne qu’elle a ou non de la « personnalité » en fonction de sa conformité à certaines catégories préétablies.
Par conséquent, nous réduisons souvent la connaissance de l’autre à la connaissance de sa personnalité, nous contentant de reconnaître : « Ah, c’est lui, ou elle, tout craché ! »
Quel est l’objet du développement personnel ?
Le développement personnel vise à développer le moi, l’ego. Il cherche à le rendre plus ceci ou moins cela. Tant que je cherche à être plus aimable ou moins agressif, je me situe dans le domaine du développement du moi, car il ne me donne pas satisfaction.
Chaque fois que je recherche une plus grande satisfaction personnelle, je me situe dans un objectif d’autosatisfaction, et non dans une recherche de liberté et de non-dépendance vis-à-vis d’un phénomène d’identification à l’ego, dont je n’ai le plus souvent même pas conscience.
Qu’est-ce qu’être libre ?
Être libre, c’est ne plus être dépendant, c’est être libre du conditionnement. Un être libre est par définition imprévisible, inattendu et parfois même déroutant pour ceux qui s’attendent à ce que l’autre soit conforme à leur analyse et à leur compréhension.
« La spiritualité, disait Swami Prajnanpad, c’est seulement un autre nom pour désigner l’indépendance et la liberté sous tous leurs aspects. »
Si je cherche à me connaître, c’est pour devenir non déterminé et libre de moi-même, et non pour développer de soi-disant qualités que j’aspire à renforcer par peur de les perdre.
Si la connaissance de la personnalité est un enjeu crucial dans la démarche psychologique, elle n’est qu’une étape secondaire dans la démarche spirituelle, qui vise à la transcender en se libérant de l’identification à l’ego.
En reconnaissant mes besoins et mes identifications sans les refuser, je parviens peu à peu à m’accepter tel que je suis, sans chercher à lutter contre mes traits de personnalité. Je les observe simplement, j’en suis le témoin, car mon intention n’est pas de les détruire en m’y opposant, mais de les dépasser. Celui qui refuse ses identifications en luttant contre lui-même les intériorise, puisqu’en les refusant il les maintient – sous le prétexte de les repousser. Ce faisant il se divise et s’empêche de les dépasser.
Si, par exemple, mon objectif est de transcender mon identification à avoir raison contre l’autre, je mets ma démarche de connaissance de soi au service de ma liberté. En aspirant à aller au-delà de ce besoin d’avoir raison, je peux choisir de rester silencieux et de ne pas répondre à ceux qui cherchent le rapport de force avec moi. Ce faisant, je rencontre mes résistances à y parvenir, en même temps que je cultive délibérément l’expérience de ne pas me mettre au premier plan, dans mon intention de devenir progressivement plus libre de l’autre.
Devenir libre c’est devenir libre de son passé, de ses schémas et de ses traumatismes, comme l’énonçait Swami Prajnanpad : « To be free is to be free from father and mother, nothing else. » Être libre, c’est être libre du père et de la mère, rien d’autre.
Qu’est-ce que la démarche spirituelle ?
La démarche spirituelle est une pratique qui cherche la disparition non pas de la personnalité mais de l’identification à la personnalité. Arnaud Desjardins l’exprime clairement quand il dit : « Vous êtes semblable à un acteur qu’on distribue dans un rôle ou dans un autre, et qui à l’intérieur de chaque rôle conserve son identité – pas son identification – et sa liberté. Demandez à un comédien de jouer le rôle d’un malade, il sait très bien qu’il est en bonne santé ; demandez-lui de jouer le rôle d’un homme ruiné, il sait très bien qu’il gagne sa vie convenablement. »
De même que le comédien, conservant son identité, n’est pas identifié à son rôle, la démarche spirituelle permet à un être de transformer les difficultés émotionnelles quotidiennes qu’il vit en situations objectives à partir desquelles il deviendra capable d’agir sans affect particulier. La démarche spirituelle permet ainsi de transformer les difficultés en opportunités consenties.
Un être qui conserve son identité propre, qui reste lui-même, qui n’est pas affecté par les situations qu’il rencontre, devient capable d’y répondre justement en toute liberté, et de manière équanime.
Pendant longtemps la personnalité est une prison qui confine les êtres, les inclinant à croire qu’elle les détermine. En réalité, la personnalité ne détermine que ceux qui s’y identifient. Encore faut-il parvenir à en faire l’expérience, car seul celui qui est parvenu à ne plus être identifié à sa personnalité sait qu’elle est une prison.
Qu’est-ce que l’identification ?
L’identification est un processus de transformation par lequel une personne adopte un trait ou un attribut d’une autre personne.
Nous nous identifions le plus souvent aux jugements que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes, en les considérant comme des vérités absolues. Ce faisant, nous ne reconnaissons pas que ces jugements ne sont vrais que pour nous.
La désidentification est l’apprentissage d’une nouvelle façon de se percevoir et de percevoir les autres avec une certaine clarté de conscience lucide. Elle n’est donc pas limitée à un développement personnel ; elle ouvre la voie à la dimension la plus profonde de l’être : la dimension spirituelle.
La désidentification est rendue possible par la pratique de la dissociation consciente3 , qui consiste à séparer le sujet de l’objet et à distinguer ce que nous sommes de nos jugements personnels. Elle ne signifie pas la disparition de la personnalité, mais plutôt la fin de l’identification à celle-ci. Par conséquent, elle s’oppose à toute recherche de développement personnel.
Dans la démarche spirituelle, l’objectif n’est pas d’améliorer les choses, mais de les transcender. C’est pourquoi on la compare souvent à la transformation d’une chenille en papillon, qui implique une mort à soi-même. Ce qu’on appelle traditionnellement, sur un chemin initiatique, « la mort du vieil homme. »
Dans le papillon, il ne reste aucune trace de la chenille. On parle de métamorphose plutôt que de transformation, d’une bascule, d’un changement de forme et de nature tel que l’être qui en est le sujet n’est plus reconnaissable.
Il est important de comprendre que si le développement personnel nourrit l’ego, la démarche spirituelle vise précisément à nous libérer de l’identification à celui-ci. Pourquoi ? Parce que la démarche spirituelle considère l’ego comme une illusion, une fausse perception de notre véritable nature.
Notre perception du monde repose sur la dualité moi / l’autre. Cela nous amène à formuler des concepts, des idées, des imaginations et des opinions que nous ne remettons jamais en question, et qui s’expriment sous la forme de « je crois que », « je pense que », « je sais que », etc. Au fil du temps, cela crée un univers intérieur et extérieur dont le centre est : « moi ». Cet univers unique, pour chacun de nous, n’est qu’un reflet de ce moi pour lequel nous nous prenons à travers nos habitudes et nos imitations. Ce moi crée des concepts et des objets intrinsèquement instables et changeants, donc irréels selon la définition védantique4, qui stipule que ce qui change constamment ne peut pas avoir d’identité propre.
« L’irréalité du monde résulte de la croyance en la réalité indépendante et autonome des innombrables objets qui le composent, le « moi » étant le premier d’entre eux. (…) Aucun objet n’est réel ou n’existe, dans le sens où aucun objet ne génère sa propre existence et que tout objet dépend d’un autre pour exister. »5
Tout est en perpétuelle mutation, en mouvement constant. Nous vivons dans l’impermanence des choses et des êtres. Tout se transforme sans cesse. Cette entité fixe appelée ego, pour laquelle nous nous prenons, n’existe pas en soi. « Moi » est une illusion, une convention. Je me prends pour « moi » par habitude de m’entendre dire « toi ». Comme l’écrivait Shakespeare dans Le Marchand de Venise : « Où va le blanc quand la neige a fondu ? »
Si ce « vous » pour lequel vous vous prenez n’est qu’une entité fluctuante, pourquoi et comment chercher à développer quelque chose qui n’existe pas ? La dimension psychologique et son corollaire, le développement personnel, considèrent que l’entité « moi » existe. Elle cherche donc à la conforter, à la fortifier, à l’encourager, à la consoler, à la faire exister davantage, alors qu’elle est déjà autre en raison de son caractère changeant. C’est pourquoi le développement personnel ne peut être attractif que pour les personnes qui se laissent séduire par leur besoin d’aller mieux, et non pour celles qui aspirent à la liberté.
Il vaut certainement mieux avoir un ego en bonne santé qu’un ego malade, mais ne nous illusionnons pas : s’occuper du développement de sa personne est, à un certain stade, une démarche narcissique et vaine parce qu’elle est incapable de nous faire sortir de la souffrance.
Il est vrai que nous devons nous être suffisamment occupés de notre personne pour envisager une démarche spirituelle (car comment celui qui souffre trop pourrait-il s’y ouvrir ?). Nous avons besoin d’avoir la tête sur les épaules en nous étant équilibrés et stabilisés. Cependant, à trop nous occuper de notre personne, nous tournons le dos à la démarche spirituelle, qui est la confrontation et l’acceptation de « ce qui est », l’ouverture au mystère et à l’incommensurable.
La démarche spirituelle n’est donc pas un développement personnel, elle est une recherche de la profondeur qui mène au-delà de la souffrance, par la découverte de la Présence à soi-même à travers notre ressenti intime. C’est cette découverte de la Présence à soi-même qui libère et guérit à la fois.
© 2025 Renaud Perronnet. Tous droits réservés.
Notes :
1. Département des Sciences du Comportement, pour aller plus loin, rendez-vous sur le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
2. Dans l’Égypte antique, les personnes en proie à des souffrances psychologiques étaient emmenées dans des temples de guérison où elles se mettaient à rêver après une période d’incubation, des prêtres interprétaient leurs rêves pour les soigner. On peut considérer cette pratique comme étant à l’origine de la psychothérapie.
3.Lire l’article : La dissociation consciente
4. Les Védas sont un ensemble de textes issus de l’Inde qui datent de plus de 4000 ans et qui affirment (dans les Upanishad) l’unité de toutes les existences : la nature de l’univers et la nature de l’individu sont une seule et même nature, diversement manifestée. Pour connaître les trois vérités fondamentales énoncées dans les Upanishad, lisez : Les malentendus fondamentaux
5. Consultez le livre d’Yves Rémond, L’éveil dans le Yogavasisstha, Éditions Almora, 2024, p. 83.
Pour aller plus loin sur le thème de la démarche spirituelle, vous pouvez lire :
- Qu’est-ce qui est réel ?
- S’initier au travail intérieur, le défi des candidats à la psychothérapie.
- Esclavage et liberté
- Comment accepter ce que l’on a subi ?
- Tagore, le lion du soleil
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article de 6 pages au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
560 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)