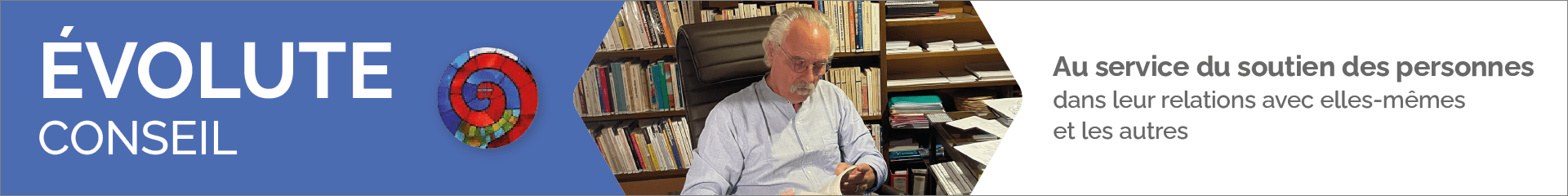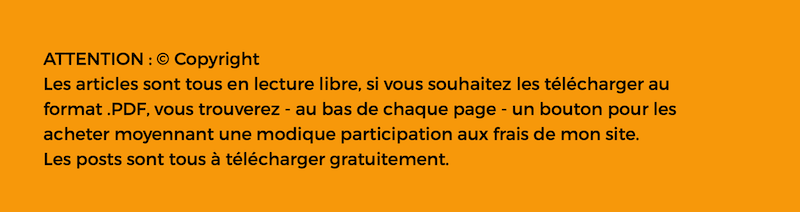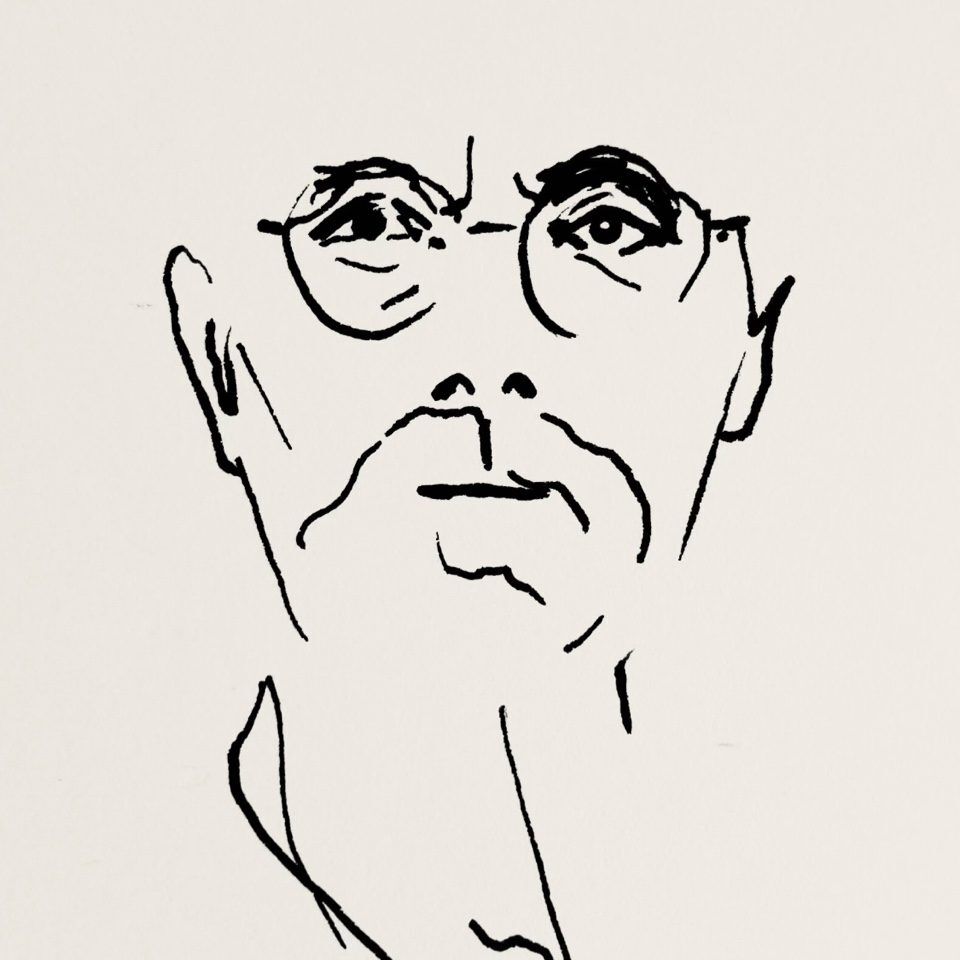« Que se passe-t-il ? demande Hamm.
Quelque chose suit son cours, répond Clov. »
Samuel Beckett, Fin De partie
« À penser anxieusement au futur, les hommes oublient le présent, de sorte qu’ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir… Et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu. »
Le Dalaï-Lama
Vous connaissez peut-être cette histoire qui illustre que l’attente est une blague parce que demain n’existe pas ?
Un barbier a placardé sur sa vitrine l’affiche sur laquelle est écrit « Demain on rase gratis ». De sorte que quand un client se fait raser, il proteste au moment de payer en évoquant l’inscription sur l’affiche. Mais le barbier lui répond : « Mais c’est écrit que ce sera gratuit demain ».
Demain est nécessairement demain par rapport à aujourd’hui, mais qu’en sera-t-il demain dans un monde dans lequel demain sera devenu aujourd’hui ?
On aura compris que la référence à demain sert les promesses de celui qui, ne voulant pas les tenir, s’adresse à notre capacité à attendre, quitte à nous faire manipuler.
Quel sens donner à l’attente dans un monde où la vie se vit instantanément dans le présent, ici et maintenant ? Un monde dans lequel le passé et le futur ne sont que des concepts mentaux qui nous évitent d’être au présent ?
Attendre signifie concentrer son attention sur quelque chose qui doit venir. Or concentrer son attention sur un événement futur implique nécessairement de s’éloigner du présent pour se tourner vers l’hypothétique, c’est-à-dire vers quelque chose qui n’existe pas autrement que comme une anticipation, une pure vue de l’esprit.
L’attente est donc intrinsèquement liée à l’espoir, un espoir nécessairement associé à l’appréhension que ce que l’on attend ne se réalise jamais. Fréquemment, les délais d’attente ne sont ni définis ni fiables, ce qui peut conduire à attendre un événement improbable, un miracle peut-être même, qui ne se produira jamais…
Notre soif d’harmonie met à l’épreuve notre capacité à attendre quelque chose qui tarde à venir, sans nous impatienter. Au même moment, notre attente ne peut qu’être une souffrance car elle nous met en relation avec un autre (autre chose) qui n’existe pas encore.
Remarquons qu’on peut arroser une plante et lui mettre de l’engrais mais qu’il est vain de tirer sur ses feuilles pour les faire pousser plus vite, ce qui signifie que nous sommes toujours tributaires de la nature des choses donc de notre impuissance.
Dès lors que nous attendons, nous nous livrons à la toute-puissance du temps.
Mais qu’est-ce que le temps ? Pour Héraclite : « Le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions : de la royauté d’un enfant. »
Cette image de l’enfant qui joue parle de l’innocence du devenir. Marcel Conche1, commentateur d’Héraclite, explique cette innocence par le constat « qu’aucun Dieu moral, aucun gouvernant bienfaisant, aucune Providence ne règnent sur toutes choses, mais seulement l’irresponsabilité et l’amoralité des puissances cosmiques. » Cela signifie que les conduites finalisées, celles qui par exemple veulent atteindre un but exprimé, n’interviennent qu’avec les hommes et leurs désirs. L’enfant-temps – lui – joue innocemment en déplaçant des pions, et cet enfant-temps est roi. L’enfant-temps joue avec la dualité des choses, avec les obstacles et la contrariété, avec la loi des contraires qui définit la nature. Car chaque « chose » a son contraire, le jour n’existe que par rapport à la nuit, le haut par rapport au bas, la guerre par rapport à la paix, la naissance en opposition avec la mort, etc. Comme le disait Samuel Beckett : « Elles accouchent à cheval sur une tombe, le jour brille un instant, puis c’est la nuit à nouveau. » L’enfant-temps joue éternellement avec les contradictions, il passe constamment de l’une à l’autre sans pouvoir les abolir. L’enfant-temps qui joue avec la dualité, ne peut influer que sur la durée des événements en ce qu’ils seront plus ou moins courts ou longs.
Rien ne reste jamais pareil, tout s’écoule à travers le temps que l’on appelle parfois aussi le destin, « Le destin est ce qui nous arrive au moment où on ne s’y attend pas. » a écrit Tahar Ben Jelloun, il est donc imprévisible, il est cet enchainement d’événements qui composent notre existence et qui découlent de causes indépendantes de notre volonté.
Que signifierait donc d’attendre le destin, ne devrait-on pas plutôt dire que c’est le destin qui nous attend ? Pour Sophocle, « Le Temps est le dieu qui aplanit tout », il est donc tout puissant, en ce sens que toutes choses cèdent à sa toute-puissance, car tout s’use.
Héraclite ne dit pas ce qui doit être, il se borne à constater ce qui est, ce qui se passe : « On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve » car la seconde fois le fleuve n’est plus le même. Comme l’explique Marcel Conche : « Entrer dans le fleuve demande du temps : pendant que nous y entrons, le fleuve cesse d’être le même, de sorte que ce n’est plus en lui que nous entrons. »
Dès lors quel sens pouvons-nous donner à l’impatience, à l’attente d’un futur espéré ? Quel sens donner à notre incapacité à nous contenir face à l’enfant-temps qui joue ?
Seul le sage, dans sa patience infinie, n’attend rien.
Un adage marocain affirme : « Les gens pressés sont déjà morts ». L’impatience témoigne de l’immaturité de celui qui – inconscient des lois qui régissent le monde – voudrait que les choses se déroulent selon ses désirs.
« Même si on aime les fleurs, elles fanent ; même si on n’aime pas les mauvaises herbes, elles poussent », affirmait le maître zen Dögen. Il n’existe aucun raccourci sur le chemin de la vie. Nul ne peut défier le cours des événements, ce qui revient à dire que tout ce qui nous arrive est nécessaire, parce qu’inévitable.
L’impatience est l’émotion qui caractérise celui qui, persuadé d’une illusoire toute-puissance, aspire à maîtriser l’enfant-roi-temps qui joue. Elle résulte d’une frustration née de notre esprit agité et confus, elle nous éloigne du moment présent et nous projette dans un futur plus ou moins lointain (et de toutes façons incertain). Est impatient celui qui n’a pas encore saisi que tout se déroule ici et maintenant.
L’impatience, en soi, n’est pas une émotion négative. Tout dépend de la manière dont nous allons la canaliser : allons-nous nous laisser dominer par elle ou allons-nous la transformer en une opportunité à saisir ?
Djalāl ad-Dīn Rûmî disait : « Le passé et le futur n’existent qu’en relation avec toi ; tous deux ne sont qu’un, c’est toi qui penses qu’ils sont deux. » Notre impatience est la conséquence de la confusion qui est la nôtre dans notre relation à l’espace-temps, ainsi que de notre refus d’accepter notre impuissance à contrôler les événements selon nos désirs. Nous pouvons donc la prendre comme un signal qui nous montre que nous nous égarons, une opportunité pour nous de revenir au présent.
Si le temps est un enfant-roi qui joue, c’est notre vigilance qui nous permettra d’apaiser, en le ralentissant, le processus de notre impatience, en revenant à nous-mêmes. En d’autres termes, il s’agit d’intervenir sur notre vécu en nous ajustant au rythme des événements tels qu’ils se déroulent.
L’attente sereine consiste à être simplement présent à ce qui est car « quelque chose suit son cours ». Au quotidien, il est possible de s’y exercer, par exemple, à travers l’exercice de la bouilloire.
À l’occasion de la préparation du thé, je mets de l’eau à bouillir dans la bouilloire, cela ne prend que quelques minutes d’apprendre à être plutôt qu’à vouloir. Plutôt que de regarder ma bouilloire à travers une émotion d’impatience, il m’est possible de me souvenir que comme le disait Jean-Yves Leloup2 : « Il n’existe pas trois temps, le passé, le présent et le futur ; il n’existe que deux temps : le présent et l’absent. »
Observer l’impatience, en pleine présence à soi-même c’est jouer consciemment son jeu, c’est apprendre à être face à la bouilloire et à l’eau qui bout. Une opportunité quotidienne pour nous rapprocher de la paix intérieure. S’ouvrir à son temps intérieur pour tempérer l’impatience. Tout se passe ici maintenant dans ma relation à l’eau qui va se mettre à frémir dans la bouilloire.
Faire de l’eau qui va bouillir un simple exercice quotidien de présence à soi-même, c’est se soumettre à l’enfant-roi qui joue et, s’y soumettant, apprendre à être.
Pour ce faire, nous devrons accueillir notre impatience sans jugement, en étant à la fois et en même temps présent et effacé, de telle manière qu’il ne restera que notre pratique.
Puisse lecteur, ta bouilloire t’aider à te rappeler à toi-même.
Notes :
1. Marcel Conche, Héraclite. Fragments recomposés, Éditions PUF, p. 81
2. Théologien et essayiste, prêtre orthodoxe, il est l’auteur de plus de quatre-vingt-dix ouvrages traitant essentiellement de spiritualité chrétienne.
© 2025 Renaud Perronnet. Tous droits réservés.
Illustration :
Edward Hopper, Woman waiting on a bus station.
Pour aller plus loin sur ces thèmes, vous pouvez lire :
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article de 4 pages au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
482 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)